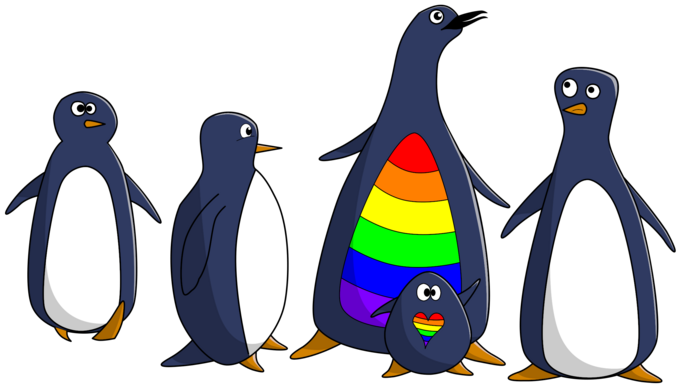Tout d'abord, Corylus, il faut garder à l'esprit le contexte dans lequel nous évoluons, ce que représente la communauté LGBT au sein de la société actuelle (en Europe de l'Ouest) et le processus de quête identitaire qui s'engage à partir du moment où l'on assume telle ou telle part de notre identité (s'entend par là tout type de part car, je l'expliquerai un peu plus tard, il n'y a pas que l'homosexualité que l'on puisse assumer. Je donnerai quelques exemples un peu plus bas).
Il faut faire attention, en premier temps, de ne pas faire d'amalgames. En effet, sans étude approfondie, on ne peut pas dire que ça soit la majorité des nanas qui se "masculinise" dès lors qu'elles assument leur homosexualité. De mon expérience personnelle, j'en ai rarement vu qui aient emprunté ce chemin : la très très (très) écrasante majorité des filles avec qui je suis sortie étaient féminines et n'avaient pas du tout l'intention de changer de style, qu'elles aient ouvertement assumé leur orientation sexuelle ou non.
Maintenant, il peut y avoir un souhait, une volonté de
visibilisation de la personne en tant que lesbienne pour divers motifs (ex : maximiser ses chances de rencontrer quelqu'un du même bord en faisant comprendre qu'elle en est aussi, sans spécialement avoir à le verbaliser) et dans cas là, le réflexe classique est de jouer avec les codes liés aux genres.
Car nous sommes dans une société bigenrée, hétéronormée, hétéronormative et patriarcale. Que veulent dire ces incantations ?
Par "bigenrée", on entend que la société considère deux genres : le genre masculin et le genre féminin. Par hétéronormée, on entend que la norme, à la fois dans les sens sociologique et statistique du terme, est l'hétérosexualité. Par hétéronormative, on entend que la société tend à faire la "promotion" de l'hétérosexualité, de
normer les rapports interindividuels par tous les canaux possible, en faisant considérer cette hétérosexualité comme la référence ou autrement dit comme "ce qui est normal". Et enfin, par "patriarcale", on entend "lié au patriarcat", c'est-à-dire, pour reprendre la définition : "une forme d’organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l’autorité par les hommes".
Tous ces éléments se nourrissent entre eux et contribuent à la perception que nous avons aujourd'hui des deux genres, et surtout, des stéréotypes de genre, autrement dit, les archétypes de ce qui est féminin et masculin.
Ainsi, parce que nous vivons dans une société patriarcale, hétéronormée et hétéronormative, le stéréotype de genre masculin sera l'homme fort, meneur, courageux - tout ce qui est lié à la force - et viendra éventuellement au secours d'une femme, qui éprouvera éventuellement pour lui des sentiments (scénario classique). Ces codes sont imprimés très tôt dans l'esprit des enfants, avec des exemples et des modèles comme le chevalier qui croise le fer pour sauver sa princesse, Action Man qui est fort, musclé et qui fait des trucs de fou, Super Man qui sauve sa fluette Loïs Lane, et j'en passe...
Autre exemple des résultats de l'interpénétration des caractéristiques que j'ai cité plus haut, le fait que nous soyons dans une société hétéronormée et bigenrée fait qu'une personne qui se dit asexuée (donc qui ne se reconnait ni dans un sexe, ni dans l'autre) passe pour une personne complètement chtarbée et en plus, on a du mal à deviner son orientation sexuelle "naturelle", parce que... "Ouais, mais c'est une fille ou un mec ?"
Or ça peut arriver et ce n'est pas "une maladie", c'est juste que la personne ne se reconnait pas dans ce modèle et c'est tout.
Alors maintenant, pourquoi je dis ça ?
Parce que c'est dans et avec tout ceci que nous construisons notre identité. En concordance avec les règles établies ou en opposition de celles-ci. Dans cette société hétéronormée et hétéronormative, la communauté LGBT fait figure de minorité. En effet, statistiquement on estime à 10% la part d'homosexuels au sein de la société. Ça veut dire que si cette communauté veut se faire respecter d'une société qui la néglige, elle doit se souder et lutter pour faire reconnaître ses droits. Et même après les avoir obtenu, elle reste, en tant que minorité, condamnée à une vigilance éternelle, parce que sinon il se pourrait que la majorité fasse machine arrière.
Pour lutter, il faut commencer par apparaître, donc être visible. A l'échelle d'un individu, quand on assume cette part de soi, ça commence plutôt naturellement une forme de différenciation si elle n'est pas "originelle". Mais ça ne passe pas forcément par le rayon homme de chez H&M

... Le discours peut simplement changer.
Car il n'y a pas que l'homosexualité qui soit "assumable" : une personne qui se converti au judaïsme parce qu'il se sent habité par la foi juive fréquentera la synagogue, fera shabbat, sera plus sensibilisé à la cause d'Israël, intériorisera certaines choses et en sortira changée. Parfois juste dans le discours, mais parfois dans tout son mode de vie, si elle intègre une communauté de juif ultra orthodoxe, par exemple.
Autre chose, et ce fut un peu mon cas, on peut aussi assumer une part de son identité qui ne fait aucun doute et avec laquelle on grandi mais que l'on ignore même si l'on y fait face tous les jours : son origine. Je suis méditerranéenne et plus précisément d'origine Marocaine. Mes deux parents. Mais,... pratiquement toute mon enfance et le début de mon adolescence, c'est mon identité Belge que j'ai le plus revendiqué. Mon identité Marocaine, elle me faisait face chaque jour dans le miroir, mais je ne la revendiquais pas. Je ne l'"assumais" pas. C'est en grandissant, en m'informant, en considérant plusieurs évènements, et surtout en faisant face au racisme qu'elle m'a explosé au visage. Et au lieu de la ravaler, eh bien moi je l'ai gardée contre moi comme un bébé que l'on veut arracher à sa mère. Mon discours a forcément changé, parce qu'ado, tu réalises, tu continues à t'informer, à te cultiver, à te former l'esprit, à réaliser tous les apports à l'humanité d'une civilisation que l'on traine aujourd'hui dans la boue, aux erreurs dans lesquels s'embourbent à nouveau la société Occidentale qui semble avoir oublié son passé, etc...
Donc, tout élément importante modifie forcément l'identité de celui qui l'assume, qu'importe le domaine que ça touche...
Sinon, je ne pense pas du tout que les couples de nanas constitués d'une nana plus "masculine" et d'une nana plus "féminine" se soient formés avec la volonté un peu inconsciente de respecter l'hétéronorme de notre société. Je crois juste que les caractères se complètent et qu'on a, bien souvent, tendance à rechercher ce qui ne nous ressemble pas (en tout cas, moi, c'est tout à fait le cas : sortir avec une nana qui me ressemble physiquement, par exemple, ça ne m'éclate pas, parce que j'aime les contrastes et que la "féminité" (stéréotype

) est quelque chose qui me fait de l'effet. Mais pas parce que je suis androgyne : juste parce que je trouve ça attirant et que je suis attirée par ce qui me complète).
Voilà voilà