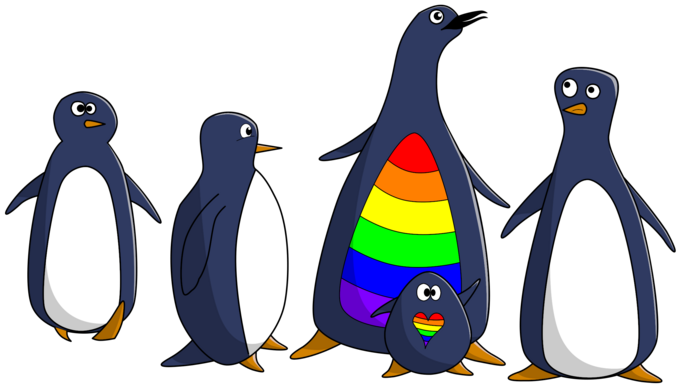Que lisez-vous ?
Re: Que lisez-vous ?
Poussière de Lune de Thomas Disch, un recueil de nouvelles, genre dans lequel il excelle.
-
Daisy.Adair
- Messages : 3567
- Inscription : dim. mars 01, 2009 1:10 am
Re: Que lisez-vous ?
Au fil de la vie, Rainer Maria Rilke
Avant ses proses et ses élégies, c'est ici à la nouvelle que s'attaque (et a débuté) Herr Rilke. Les premières lignes sont déroutantes, où est l'auteur dedans ? Puis revient après sa fascination pour la mort, avec un certain humour noir rappelant chaque ouverture d'épisodes de Six Feet Under ou encore les décès absurdes de Dead Like Me, le tout avec le décor et la voix off de Pushing Daisies. Un régal !
Le coupeur de roseaux, Junichiro Tanizaki
« Lors d'une promenade autour d'un ancien palais impérial, le sanctuaire de Minase, le narrateur rencontre un homme étrange. Est-ce un fantôme, un esprit qui hante les lieux ? Celui-ci lui offre du saké et lui raconte l'histoire de la belle O-Yû, perverse et inaccessible… » nous en dit la quatrième de couverture. Découpé indirectement en deux parties, la première nous offre la vision du paysage telle que le conçoit l'auteur. Perception de la nature par ces génies hostiles aux mondanités humaines, déploiement des matières végétales, et haïkus sont au rendez-vous. La seconde nous renvoie quant à elle aux conflits humains. Honneur, dignité, sculpture vivante et culte des morts, non-dits et ruses, secrets cachés et huit clos… Une visite au temps des daimyo. Plaisant.
La vierge des glaces, Hans Christian Andersen
Le conte débute sur le sauvetage miraculeux de l'enfant Rudy ayant échappé de justesse à la redoutable Vierge des glaces, attrapant quiconque ose s'aventurer dans son palais de montagnes enneigées surplombant les prairies, vallées, moulins et autres habitas de la Suisse et de ses environs. « On ne tombe pas quand on n'y croit pas ! » déclare le courageux et chanceux Rudy qui au fil de sa vie devient la coqueluche de toute la région, aussi bien des chasseurs que des jeunes filles. Mais la vierge des glaces guette, attend, et chaque aventure de Rudy sur ses terres sont une tentative de plus accordée à la Reine des neiges pour l'attraper et l'engloutir au plus profond de ses crevasses cristallines. Il y a un peu de Kirikou, échappant à la Sorcière, des images de hauteurs aériennes (l'air frai et vivifiant si apprécié par tonton Nietzsche ?), de gouffres aquatiques, mais Ocelot ou Disney n'étant pas aux commandes de l'intrigue, l'histoire n'en devient que plus insoupçonnable.
Papillon, suivi de La lionne, Yukio Mishima
Deux histoires, une cantatrice oisive sur son déclin chantant Mme Butterfly, une femme désabusée par son mari et désireuse de se venger. Deux intrigues où les talents de l'auteur — le détail, la thématique, la description ou encore l'ellipse — prennent leur essor dans deux visions animalières et symboliques de deux japonaises dont le destin funeste, théâtral ou manipulateur, laisse en nous une inquiétante étrangeté face au psychisme humain. Les adeptes de Mishima (non, je ne parle pas des modistes vouant un culte à Confession d'un Masque uniquement pour lire des mots sur l'homosexualité) ne peuvent que se ruer dessus.
Avant ses proses et ses élégies, c'est ici à la nouvelle que s'attaque (et a débuté) Herr Rilke. Les premières lignes sont déroutantes, où est l'auteur dedans ? Puis revient après sa fascination pour la mort, avec un certain humour noir rappelant chaque ouverture d'épisodes de Six Feet Under ou encore les décès absurdes de Dead Like Me, le tout avec le décor et la voix off de Pushing Daisies. Un régal !
Le coupeur de roseaux, Junichiro Tanizaki
« Lors d'une promenade autour d'un ancien palais impérial, le sanctuaire de Minase, le narrateur rencontre un homme étrange. Est-ce un fantôme, un esprit qui hante les lieux ? Celui-ci lui offre du saké et lui raconte l'histoire de la belle O-Yû, perverse et inaccessible… » nous en dit la quatrième de couverture. Découpé indirectement en deux parties, la première nous offre la vision du paysage telle que le conçoit l'auteur. Perception de la nature par ces génies hostiles aux mondanités humaines, déploiement des matières végétales, et haïkus sont au rendez-vous. La seconde nous renvoie quant à elle aux conflits humains. Honneur, dignité, sculpture vivante et culte des morts, non-dits et ruses, secrets cachés et huit clos… Une visite au temps des daimyo. Plaisant.
La vierge des glaces, Hans Christian Andersen
Le conte débute sur le sauvetage miraculeux de l'enfant Rudy ayant échappé de justesse à la redoutable Vierge des glaces, attrapant quiconque ose s'aventurer dans son palais de montagnes enneigées surplombant les prairies, vallées, moulins et autres habitas de la Suisse et de ses environs. « On ne tombe pas quand on n'y croit pas ! » déclare le courageux et chanceux Rudy qui au fil de sa vie devient la coqueluche de toute la région, aussi bien des chasseurs que des jeunes filles. Mais la vierge des glaces guette, attend, et chaque aventure de Rudy sur ses terres sont une tentative de plus accordée à la Reine des neiges pour l'attraper et l'engloutir au plus profond de ses crevasses cristallines. Il y a un peu de Kirikou, échappant à la Sorcière, des images de hauteurs aériennes (l'air frai et vivifiant si apprécié par tonton Nietzsche ?), de gouffres aquatiques, mais Ocelot ou Disney n'étant pas aux commandes de l'intrigue, l'histoire n'en devient que plus insoupçonnable.
Papillon, suivi de La lionne, Yukio Mishima
Deux histoires, une cantatrice oisive sur son déclin chantant Mme Butterfly, une femme désabusée par son mari et désireuse de se venger. Deux intrigues où les talents de l'auteur — le détail, la thématique, la description ou encore l'ellipse — prennent leur essor dans deux visions animalières et symboliques de deux japonaises dont le destin funeste, théâtral ou manipulateur, laisse en nous une inquiétante étrangeté face au psychisme humain. Les adeptes de Mishima (non, je ne parle pas des modistes vouant un culte à Confession d'un Masque uniquement pour lire des mots sur l'homosexualité) ne peuvent que se ruer dessus.
Re: Que lisez-vous ?
Petite pause dans le Disch (beaucoup de mal à lire de la fiction en ce moment) pour rire comme un bossu en lisant La sainte famille de Marx, son pamphlet contre les Jeunes-hégéliens, Eugène Sue, etc.
-
April-istic
- Messages : 11
- Inscription : lun. oct. 25, 2010 11:56 am
Re: Que lisez-vous ?
P. Claudel - Les âmes grises.
Troisième fois de ce mois-ci.
Je m'attarderais volontiers, ensuite, sur La Fée Carabine de Pennac... =)
Troisième fois de ce mois-ci.
Je m'attarderais volontiers, ensuite, sur La Fée Carabine de Pennac... =)
Re: Que lisez-vous ?
Le Réel et son double de Clément Rosset. 1976.
Curieux petit essai, protéiforme, ironique et inégal. Ce serait difficile de le résumer en quelques lignes ; d'autant plus que ce qu'il m'a vraiment évoqué est lié à d'autres lectures, par exemple la nouvelle les Sangsues du Temps de G. Meyrink. (En parlant des oracles, Rosset dit qu'ils créent une "attente" quant à comment le principal intéressé suppose qu'il se déroulera ; or, il se réalisera effectivement différemment ; le réel se dédouble. Et comme l'attente porte plus sur le double, c'est le réel qui paraît paradoxalement le moins réel. La nouvelle de Meyrink porte sur un cheminement métaphysique : éliminer toute forme d'attente). “L'âme humaine est en papier” est une phrase qui m'a marqué au fer rouge pour un tas d'autres raisons.
Curieux petit essai, protéiforme, ironique et inégal. Ce serait difficile de le résumer en quelques lignes ; d'autant plus que ce qu'il m'a vraiment évoqué est lié à d'autres lectures, par exemple la nouvelle les Sangsues du Temps de G. Meyrink. (En parlant des oracles, Rosset dit qu'ils créent une "attente" quant à comment le principal intéressé suppose qu'il se déroulera ; or, il se réalisera effectivement différemment ; le réel se dédouble. Et comme l'attente porte plus sur le double, c'est le réel qui paraît paradoxalement le moins réel. La nouvelle de Meyrink porte sur un cheminement métaphysique : éliminer toute forme d'attente). “L'âme humaine est en papier” est une phrase qui m'a marqué au fer rouge pour un tas d'autres raisons.
-
Daisy.Adair
- Messages : 3567
- Inscription : dim. mars 01, 2009 1:10 am
Re: Que lisez-vous ?
L'arbre, Pierre Magnan
Au sein de Montfuron, un chêne déclenche une succession de querelles entre les habitants de ce petit village du Lubéron. Maires, notaires, épouses, docteurs, curés, tous se disputent la propriété de cette terre où siège de manière intemporelle cet arbre recueillant superstitions et personnifications ésotériques locales. Montfuronnais le plus ancien, encore plus ancien que ledit village même, le chêne annoncerait, dit-on, la mort d'un passant dans les trois mois à venir lorsque celui-ci s'embrase illusoirement sous les yeux d'un autre passant accompagnant le futur défunt.
Assez lent à démarrer, le temps de placer le décor provençal et ses intrigues politiques, l'histoire décolle au moment où l'on bascule d'un naturalisme français sudiste et emmerdifiant ( ah, le Collège, avec tous ces Hussards, ces Trestoulats, ces enfants et rivières, bon débarras ) à une légende élémentaire : le chêne s'illumine sous les yeux d'un passant. Entre deux disputes de pouvoir, l'arbre, tel un oracle, révèle implicitement le destin qui attend le montfuronnais passé sous ses branches. Pourquoi lui l'a vu s'embraser et pas moi ? Doit-on s'y fier ou non ? Dieu se manifesterait-il à travers ce chêne ? La jalousie s'installe peu à peu dans les esprits, et ce qui au début s'avérait être qu'une banale succession de guerres intra-communales devient une lutte de l'homme face aux phénomènes naturels contre lesquels a priori il ne peut rien si ce n'est mourir.
) à une légende élémentaire : le chêne s'illumine sous les yeux d'un passant. Entre deux disputes de pouvoir, l'arbre, tel un oracle, révèle implicitement le destin qui attend le montfuronnais passé sous ses branches. Pourquoi lui l'a vu s'embraser et pas moi ? Doit-on s'y fier ou non ? Dieu se manifesterait-il à travers ce chêne ? La jalousie s'installe peu à peu dans les esprits, et ce qui au début s'avérait être qu'une banale succession de guerres intra-communales devient une lutte de l'homme face aux phénomènes naturels contre lesquels a priori il ne peut rien si ce n'est mourir.
Au final, l'auteur pioche dans le symbolisme (arbre et feu) son récit qu'il situe dans les terres de son enfance. Prévisible dans sa thématique de la possession, redondant dans les imaginations traitées, parfois dangereusement conservateur et apitoyant, on se promène dans l'Arbre comme dans une région déjà visitée, on rit à certains moments de l'absurdité des décès de ses personnages, et on referme le livre en se disant que pour la somme modique de 2€, on ne chipotera pas d'un air de déjà vu.
Au sein de Montfuron, un chêne déclenche une succession de querelles entre les habitants de ce petit village du Lubéron. Maires, notaires, épouses, docteurs, curés, tous se disputent la propriété de cette terre où siège de manière intemporelle cet arbre recueillant superstitions et personnifications ésotériques locales. Montfuronnais le plus ancien, encore plus ancien que ledit village même, le chêne annoncerait, dit-on, la mort d'un passant dans les trois mois à venir lorsque celui-ci s'embrase illusoirement sous les yeux d'un autre passant accompagnant le futur défunt.
Assez lent à démarrer, le temps de placer le décor provençal et ses intrigues politiques, l'histoire décolle au moment où l'on bascule d'un naturalisme français sudiste et emmerdifiant ( ah, le Collège, avec tous ces Hussards, ces Trestoulats, ces enfants et rivières, bon débarras
Au final, l'auteur pioche dans le symbolisme (arbre et feu) son récit qu'il situe dans les terres de son enfance. Prévisible dans sa thématique de la possession, redondant dans les imaginations traitées, parfois dangereusement conservateur et apitoyant, on se promène dans l'Arbre comme dans une région déjà visitée, on rit à certains moments de l'absurdité des décès de ses personnages, et on referme le livre en se disant que pour la somme modique de 2€, on ne chipotera pas d'un air de déjà vu.
Re: Que lisez-vous ?
Le monde sans fin des jeux vidéos de Maxime Coulombe.
Ou comment expliquer le fulgurant succès des jeux de rôles en ligne, et en particulier du plus célèbre d'entre eux, World of Warcraft ? On pourra peut-être reprocher à l'auteur de dire savamment certaines idées qui viennent spontanément sans qu'il ne soit ressenti le besoin de brandir des notions aussi complexes que, par exemple, le Grand Autre lacanien. La foule d'auteur invoquée pour justifier un propos somme toute assez évident peut sembler à de l'académisme envahissant.
Mais il n'empêche qu'il est aussi des qualités à ce travail : premièrement, le sujet, suffisamment surprenant pour attirer l'attention et éveiller la curiosité. Deuxièmement, même si les idées soulevées sont, me semble-t-il, assez classiques (le jeu vidéo comme manière d'échapper, en de multiples manières, à la réalité et son oppressant vide de sens ou encore, comme nouveau moyen de valorisation sociale, au travers des réalisations et de leurs récompenses immédiatement visibles de l'avatar), elles permettent, tout en l'abordant, d'éviter de sombrer dans le poncif des joueurs fuyant leurs responsabilités ou préférant s'épanouir dans un monde virtuel, moins sibyllin dans son fonctionnement que notre monde hyper-moderne. La fuite est effectivement un argument pour ces jeux qui, dans une suspension du temps qu'eux seuls savent orchestrer, nous permettent de nous immerger corps et âme (et quasiment de manière littérale : il suffit de regarder un joueur pour s'en persuader ...) dans un monde féerique : le jeu serait alors un de ces remèdes sédatifs dont parle Freud dans son Malaise dans la culture.
Mais au contraire, l'auteur en fait la conséquence des pressions que fait peser sur l'individu la société actuelle : l'engouement pour les MMORPG ne serait alors que le symptôme d'évitement d'un "mal" beaucoup plus englobant : la valorisation d'un super-individu soumis à de nouveaux impératifs de réussite : "fais comme tu l'entends, mais sois performant !", "à toi de choisir, mais n'échoue pas !" (cf les travaux d'Alain Ehrenberg). Ainsi, les références culturelles dont Blizzard s'est emparé pour créer WoW sont d'une telle densité que le jeu apporte les réponses, dans son univers réglé, aux questions qui résonnent, telles des échos, dans le vide de nos individualités hyper-modernes : elles donnent un sens à la destiné de l'avatar incarné par les joueurs, sens absent a priori dans l'existence humaine (l'existence précède l'essence, l'existentialisme) : grimper des niveaux, accomplir des quêtes, éliminer des ennemis. Sens qui permet ensuite de gagner une reconnaissance des autres joueurs, les preuves de la réussite des objectifs fixés à l'avatar se matérialisant immédiatement sur lui : gain de niveaux, inventaire plus puissant, apparence qui change, monture imposante.
Ce qui amène au dernier point : WoW est un formidable et gigantesque outil de socialisation. On joue entre amis, on se lie d'amitié avec les membres de sa guilde, on se donne des rendez-vous précis, on aide (ou martyrise, au choix) les nouveaux joueurs ... Le joueur a beau être seul devant son écran, il n'est quasiment jamais seul dans le jeu. Et il a des obligations de justification envers les autres joueurs pour son comportement : les guildes ne sont alors qu'une nouvelle forme de socialisation.
Au final, je conseille cette lecture, ne serait-ce que parce que je trouve le thème assez surprenant en sociologie, loin des discours éclusés sur la lutte des classes, la mondialisation et tout le tintouin.
Ou comment expliquer le fulgurant succès des jeux de rôles en ligne, et en particulier du plus célèbre d'entre eux, World of Warcraft ? On pourra peut-être reprocher à l'auteur de dire savamment certaines idées qui viennent spontanément sans qu'il ne soit ressenti le besoin de brandir des notions aussi complexes que, par exemple, le Grand Autre lacanien. La foule d'auteur invoquée pour justifier un propos somme toute assez évident peut sembler à de l'académisme envahissant.
Mais il n'empêche qu'il est aussi des qualités à ce travail : premièrement, le sujet, suffisamment surprenant pour attirer l'attention et éveiller la curiosité. Deuxièmement, même si les idées soulevées sont, me semble-t-il, assez classiques (le jeu vidéo comme manière d'échapper, en de multiples manières, à la réalité et son oppressant vide de sens ou encore, comme nouveau moyen de valorisation sociale, au travers des réalisations et de leurs récompenses immédiatement visibles de l'avatar), elles permettent, tout en l'abordant, d'éviter de sombrer dans le poncif des joueurs fuyant leurs responsabilités ou préférant s'épanouir dans un monde virtuel, moins sibyllin dans son fonctionnement que notre monde hyper-moderne. La fuite est effectivement un argument pour ces jeux qui, dans une suspension du temps qu'eux seuls savent orchestrer, nous permettent de nous immerger corps et âme (et quasiment de manière littérale : il suffit de regarder un joueur pour s'en persuader ...) dans un monde féerique : le jeu serait alors un de ces remèdes sédatifs dont parle Freud dans son Malaise dans la culture.
Mais au contraire, l'auteur en fait la conséquence des pressions que fait peser sur l'individu la société actuelle : l'engouement pour les MMORPG ne serait alors que le symptôme d'évitement d'un "mal" beaucoup plus englobant : la valorisation d'un super-individu soumis à de nouveaux impératifs de réussite : "fais comme tu l'entends, mais sois performant !", "à toi de choisir, mais n'échoue pas !" (cf les travaux d'Alain Ehrenberg). Ainsi, les références culturelles dont Blizzard s'est emparé pour créer WoW sont d'une telle densité que le jeu apporte les réponses, dans son univers réglé, aux questions qui résonnent, telles des échos, dans le vide de nos individualités hyper-modernes : elles donnent un sens à la destiné de l'avatar incarné par les joueurs, sens absent a priori dans l'existence humaine (l'existence précède l'essence, l'existentialisme) : grimper des niveaux, accomplir des quêtes, éliminer des ennemis. Sens qui permet ensuite de gagner une reconnaissance des autres joueurs, les preuves de la réussite des objectifs fixés à l'avatar se matérialisant immédiatement sur lui : gain de niveaux, inventaire plus puissant, apparence qui change, monture imposante.
Ce qui amène au dernier point : WoW est un formidable et gigantesque outil de socialisation. On joue entre amis, on se lie d'amitié avec les membres de sa guilde, on se donne des rendez-vous précis, on aide (ou martyrise, au choix) les nouveaux joueurs ... Le joueur a beau être seul devant son écran, il n'est quasiment jamais seul dans le jeu. Et il a des obligations de justification envers les autres joueurs pour son comportement : les guildes ne sont alors qu'une nouvelle forme de socialisation.
Au final, je conseille cette lecture, ne serait-ce que parce que je trouve le thème assez surprenant en sociologie, loin des discours éclusés sur la lutte des classes, la mondialisation et tout le tintouin.
Re: Que lisez-vous ?
La Course au mouton sauvage, d'Haruki Murakami.
C'est délirant, léger, ça fait du bien pour s'évader.
Je n'ai pas fini Marguerite Yourcenar, une écriture en mal de mère de Carole Allamand : entre jeux de mot tirés par les cheveux et psychanalyse de comptoir, les essais littéraires sont facilement du grand n'importe quoi, ou plutôt du grand vide bourrés à l'épate.
C'est délirant, léger, ça fait du bien pour s'évader.
Je n'ai pas fini Marguerite Yourcenar, une écriture en mal de mère de Carole Allamand : entre jeux de mot tirés par les cheveux et psychanalyse de comptoir, les essais littéraires sont facilement du grand n'importe quoi, ou plutôt du grand vide bourrés à l'épate.
Re: Que lisez-vous ?
Je ne lis pas. Les mots se dérobent. Allez savoir. Je ne lis pas. Rien ne reste des pages fiévreuses sinon l'engramme de quelques habitudes. On se protège comme on peut. Je ne lis pas. Ma bibliothèque s'ouvre comme quelque fleur obscène sur les moiteurs de tout-savoir. Mais cela ne fait pas l'once d'une connaissance.
Sinon accessoirement deux ou trois trucs sur Heidegger - une chose récente - et l'Avadhût Gîtâ, qu'il n'est pas en mon pouvoir de décrire ou commenter.
Sinon accessoirement deux ou trois trucs sur Heidegger - une chose récente - et l'Avadhût Gîtâ, qu'il n'est pas en mon pouvoir de décrire ou commenter.
-
amélie-sens
- Messages : 3378
- Inscription : mer. août 26, 2009 10:29 am
Re: Que lisez-vous ?
battements d'ailes de milena Angus : déçue je suis, ça se lit vite mais peu de substance (pour qq'une qui a la dalle, hihihi)
et puis je finis le p besson qui fait vivre le tableau de hopper...
et puis je finis le p besson qui fait vivre le tableau de hopper...