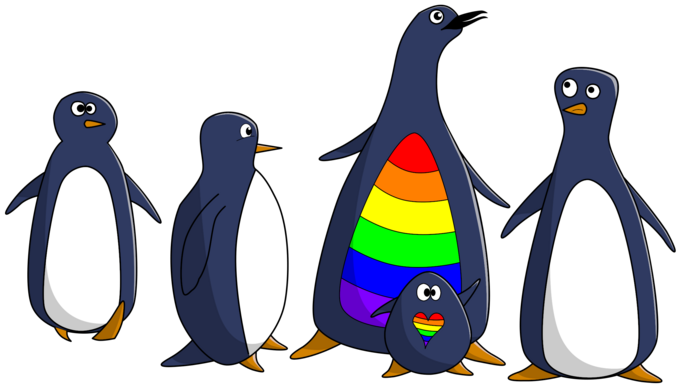La prose qui vous touche
-
the mask and the mirror
- Messages : 603
- Inscription : jeu. juin 30, 2005 1:41 pm
Un passage issu de "Tereza Batista", roman de Jorge Amado :
"Ses enfants venaient rarement voir Son Excellence dans sa province lointaine. Dona Beatriz, soucieuse des convenances, dans un catéchisme de raisons et de promesses, obtenait de temps à autre que l'un d'eux l'accompagne dans ses visites à l'époux et père, ennuyeuses sans doute, mais indispensables au bon renom de la famille. Daniel, le plus rebelle et le moins disponible, ne s'était pas embarqué depuis cinq ans dans le poussif omnibus de l'Est brésilien - pourquoi devrais-je aller m'enterrer un mois dans ce trou perdu, mater, alors que je peux voir le paternel quand il montre son nez ici, sans compter que pour ces vacances j'ai déjà des projets - en revanche, il avait visité Rio, São Paulo, Montevido, Buenos Aires, en compagnie et aux frais de généreuses dévotes de son physique et de ses talents. Cette fois, pourtant, dona Beatriz n'avait pas eu besoin d'argumenter ou de supplier; d'une façon inespérée, Daniel se proposa pour le voyage : je veux changer d'air, mater! Ainsi seulement il se débarrasserait de dona Pérola Schuartz Leão, vieille peau conservée dans les cosmétiques et les bijoux, lamentable caricature de jeune fille; elle ne pouvait plus rire tant on lui avait étiré la peau du visage, argent en pagaille et virulente odeur d'ail. Veuve pauliste et sexagénaire en visite dans les églises de Bahia, dans celle de São Francisco elle avait rencontré le jeune étudiant, baroque et céleste, elle perdit la tête et la maîtrise de soi, loua une maison sur la plage, lui ouvrit sa bourse. L'argent de l'industrie du jersey allait directement aux caprices de Tânia, petite mûlatresse pétulante, nouvelle au bordel de Tiburcia, dont Daniel s'était entiché.
Il se fatigua des deux en même temps. Aucune chirurgie ne put atténuer l'odeur d'ail de dona Pérola; l'argent, les cajoleries gâtèrent la simplicité de Tânia, la rendant capricieuse et exigeante - les passions de Dan étaient des feux de paille. Il lui restait la fuite, et il partit avec dona Beatriz pour les frontières de l'Etat où son père rendait la justice et écrivait des sonnets d'amour."
"Ses enfants venaient rarement voir Son Excellence dans sa province lointaine. Dona Beatriz, soucieuse des convenances, dans un catéchisme de raisons et de promesses, obtenait de temps à autre que l'un d'eux l'accompagne dans ses visites à l'époux et père, ennuyeuses sans doute, mais indispensables au bon renom de la famille. Daniel, le plus rebelle et le moins disponible, ne s'était pas embarqué depuis cinq ans dans le poussif omnibus de l'Est brésilien - pourquoi devrais-je aller m'enterrer un mois dans ce trou perdu, mater, alors que je peux voir le paternel quand il montre son nez ici, sans compter que pour ces vacances j'ai déjà des projets - en revanche, il avait visité Rio, São Paulo, Montevido, Buenos Aires, en compagnie et aux frais de généreuses dévotes de son physique et de ses talents. Cette fois, pourtant, dona Beatriz n'avait pas eu besoin d'argumenter ou de supplier; d'une façon inespérée, Daniel se proposa pour le voyage : je veux changer d'air, mater! Ainsi seulement il se débarrasserait de dona Pérola Schuartz Leão, vieille peau conservée dans les cosmétiques et les bijoux, lamentable caricature de jeune fille; elle ne pouvait plus rire tant on lui avait étiré la peau du visage, argent en pagaille et virulente odeur d'ail. Veuve pauliste et sexagénaire en visite dans les églises de Bahia, dans celle de São Francisco elle avait rencontré le jeune étudiant, baroque et céleste, elle perdit la tête et la maîtrise de soi, loua une maison sur la plage, lui ouvrit sa bourse. L'argent de l'industrie du jersey allait directement aux caprices de Tânia, petite mûlatresse pétulante, nouvelle au bordel de Tiburcia, dont Daniel s'était entiché.
Il se fatigua des deux en même temps. Aucune chirurgie ne put atténuer l'odeur d'ail de dona Pérola; l'argent, les cajoleries gâtèrent la simplicité de Tânia, la rendant capricieuse et exigeante - les passions de Dan étaient des feux de paille. Il lui restait la fuite, et il partit avec dona Beatriz pour les frontières de l'Etat où son père rendait la justice et écrivait des sonnets d'amour."
-
RadamanthysFr
- Messages : 58
- Inscription : jeu. juin 30, 2005 7:36 pm
-
fredouille
- Messages : 8234
- Inscription : mer. juin 29, 2005 8:31 pm
La lettre du voyant de Rimbeau ca compte????
J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. je commence de suite par un psaume d'actualité :
CHANT DE GUERRE PARISIEN
-Voici de la prose sur l'avenir de la poésie-
Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, Vie harmonieuse. - De la Grèce au mouvement romantique, moyen âge, - il y a des lettres, des versificateurs. D'Ennius à Theroldus, de Theroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, le fort, le grand. - On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que le Divin Sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'Origines. - Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !
Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitudes sur le sujet que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux d'exécrer les ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.
On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé ? Les Critiques ! ! Les Romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur?
Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident . J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène.
Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !
En Grèce, ai-je dit, vers et lyres, rythment l'Action. Après, musique et rimes sont jeux, délassements. L'étude de ce passé charme les curieux : plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités : -c'est pour eux. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées naturellement ; les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau ; on agissait par, on en écrivait des livres : telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé !
La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il la doit cultiver : cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage.
Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.
Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! - Car il arrive à l'inconnu ! - Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu ; et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu'il crêve dans son bondissement par les choses inouïes et innommables : viendront d'autres horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé!
- La suite à six minutes. -
Ici j'intercale un second psaume hors du texte : veuillez tendre une oreille complaisante, et tout le monde sera charmé. - J'ai l'archet en main, je commence :
MES PETITES AMOUREUSES
Voilà. Et remarquez bien que, si je ne craignais de vous faire débourser plus de 60 c. de port, -moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai pas tenu un seul rond de bronze ! - je vous livrerais encore mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma Mort de Paris, deux cents hexamètres !
- Je reprends :
Donc le poète est vraiment voleur de feu.
Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme ; si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue ;
- Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra ! Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, - pour parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie ! -
Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps, dans l'âme universelle : il donnerait plus que la formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au Progrès ! Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès !
Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. -Toujours pleins du Nombre et de l'Harmonie, les poèmes seront faits pour rester. -Au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque.
L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action ; elle sera en avant.
Ces poètes seront ! Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme -jusqu'ici abominable, - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? - Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les comprendrons.
En attendant, demandons aux poètes du nouveau, - idées et formes. Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande : -ce n'est pas cela !
Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte: la culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents: locomotives abandonnées, mais brûlantes, que prennent quelque temps les rails. -Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. - Hugo, trop cabochard, a bien du VU dans les derniers volumes : Les Misérables sont un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous main : Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de Jehovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées.
Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises de visions, - que sa paresse d'ange a insultées ! Ô ! les contes et les proverbes fadasses ! ô les Nuits ! ô Rolla ! ô Namouna ! ô la Coupe! tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré; français, pas parisien ! Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean La Fontaine, commenté par M. Taine ! Printanier, l'esprit de Musset ! Charmant, son amour ! En voilà, de la peinture à l'émail, de la poésie solide ! On savourera longtemps la poésie française, mais en France. Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollaque; tout séminariste emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un carnet. A quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec cœur; à dix-huit ans, à dix-sept même, tout collégien qui a le moyen fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n'a rien su faire. Il y avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé les yeux. Français, panadis, traîné de l'estaminet au pupitre du collège, le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le réveiller par nos abominations !
Les seconds romantiques sont très voyants : Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste ; et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnu réclament des formes nouvelles.
Rompus aux formes vieilles : parmi les innocents, A. Renaud, - a fait son Rolla, - L. Grandet, - a fait son Rolla ; - les gaulois et les Musset, G. Lafenestre, Coran, C. L. Popelin, Soulary, L. Salles. Les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, Lemoyne, les Deschamps, les Des Essarts ; les journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches, X. de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ; les bohèmes ; les femmes ; les talents, Léon Dierx et Sully-Prudhomme, Coppée; -la nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Mérat et Paul Verlaine, un vrai poète. Voilà. Ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant pieux.
ACCROUPISSEMENTS
Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite, car dans huit jours je serai à Paris, peut-être.
Au revoir.
A. RIMBAUD.
Cette petite nouvelle est effectivement assez scotchante je trouve (en tout cas ça m'a fait cet effet la première fois que je l'ai lue). L'auteur, Chester Himes (qui était donc Noir), en connaît d'ailleurs un bout sur la question puisqu'il a passé à l'époque sept ans en prison pour vol à main armée (condamné à vingt ans dans un premier temps).mestic a écrit :merci edogawa.
Bêtise humaine quand tu nous tient
Je conseille sans aucun doute "La reine des pommes", peut-être le meilleur policier qu'il m'ait été donné de lire. Il s'est toujours battu pour la condition des Noirs avec un humour corrosif et grinçant (il maniait l'ironie comme personne). Sacré personnage!
La nouvelle en question est issue d'un recueil de textes dont le titre est "Noir sur noir" en français.
Un petit passage du roman "Dorian" de Will Self :
"Plus loin, le Furet pérorait aussi, en tapotant le revers de sa veste (moins tranchant que celui de Dorian) :
"Je ne porte pas toujours ce ruban contre le sida, vous savez.
- Pourquoi ? dit sa voisine, Manuela Sanchez, une artiste hispanique lesbienne formidablement stéréotypée, avec cigare, monocle, redingote rouge et cravate noire.
- Parce que, ma chère Manuela, ça ne va pas toujours avec mes habits - vous devez me comprendre.
- Je pense que ce ruban n'a rien à voir avec la mode... c'est une prise de position politique.
- Ah mais, Manuela, le XXe siècle finissant exige de nous que nos prises de positions politiques soient à la mode, de même que la mode se doit d'être politique. Je prédis que, à long terme, il y aura tout un choix de rubans de ce type, chacun proclamant la solidarité de son porteur avec telle catégorie de malade ou telle tribu indigène en voie d'extinction.
- Peuh! fit-elle en lui soufflant de la fumée de cigare au visage. Vous, les Anglais, vous ne dites jamais ce que vous pensez.
- Au contraire, je dis toujours ce que je pense, même si je pense rarement ce que je dis."
Encore plus loin, Gavin entretenait Baz de la vie et de la mort dans les services hospitaliers.
"Il avait le côlon crevé, dit-il en parlant d'un patient, par un type qui l'avait enculé avec le poing.
- Vingt dieux! dit Baz. Le type avait des serres de rapace ou quoi ?
- Non, répondit Gavin avec un ricanement macabre, sauf si vous croyez que le mariage vous donne des ailes et vous transforme en aigle. Le type était marié et n'avait pas pensé à retirer son alliance.""
"Plus loin, le Furet pérorait aussi, en tapotant le revers de sa veste (moins tranchant que celui de Dorian) :
"Je ne porte pas toujours ce ruban contre le sida, vous savez.
- Pourquoi ? dit sa voisine, Manuela Sanchez, une artiste hispanique lesbienne formidablement stéréotypée, avec cigare, monocle, redingote rouge et cravate noire.
- Parce que, ma chère Manuela, ça ne va pas toujours avec mes habits - vous devez me comprendre.
- Je pense que ce ruban n'a rien à voir avec la mode... c'est une prise de position politique.
- Ah mais, Manuela, le XXe siècle finissant exige de nous que nos prises de positions politiques soient à la mode, de même que la mode se doit d'être politique. Je prédis que, à long terme, il y aura tout un choix de rubans de ce type, chacun proclamant la solidarité de son porteur avec telle catégorie de malade ou telle tribu indigène en voie d'extinction.
- Peuh! fit-elle en lui soufflant de la fumée de cigare au visage. Vous, les Anglais, vous ne dites jamais ce que vous pensez.
- Au contraire, je dis toujours ce que je pense, même si je pense rarement ce que je dis."
Encore plus loin, Gavin entretenait Baz de la vie et de la mort dans les services hospitaliers.
"Il avait le côlon crevé, dit-il en parlant d'un patient, par un type qui l'avait enculé avec le poing.
- Vingt dieux! dit Baz. Le type avait des serres de rapace ou quoi ?
- Non, répondit Gavin avec un ricanement macabre, sauf si vous croyez que le mariage vous donne des ailes et vous transforme en aigle. Le type était marié et n'avait pas pensé à retirer son alliance.""
j'adôre (le coup de l'alliance aussiedogawa a écrit : - Je pense que ce ruban n'a rien à voir avec la mode... c'est une prise de position politique.
- Ah mais, Manuela, le XXe siècle finissant exige de nous que nos prises de positions politiques soient à la mode, de même que la mode se doit d'être politique.
Le bouquin recèle 350 pages de cet humour dévastateur!Shana75 a écrit :j'adôre (le coup de l'alliance aussiedogawa a écrit : - Je pense que ce ruban n'a rien à voir avec la mode... c'est une prise de position politique.
- Ah mais, Manuela, le XXe siècle finissant exige de nous que nos prises de positions politiques soient à la mode, de même que la mode se doit d'être politique.)
Une petite nouvelle de Chester Himes écrite en 1945. Deux personnes devraient la lire à tout casser mais tant pis, je ne résiste pas :
"Il ne lui manque que les pieds"
Ward marchait sur le trottoir à Rome, en Georgie, lorsqu'il croisa une Blanche et deux hommes blancs : il descendit du trottoir pour les laisser passer.
Mais l'homme blanc le heurta quand même, puis se retourna pour lui dire :
"Qu'est-ce qui te prend, sale nègre, il te faut toute la rue ?
- Oh, écoutez, messieurs dames", commença Ward, mais l'homme blanc lui donna une bourrade :
"Allez, fous le camp, sale nègre, avant qu'il t'arrive des histoires.
- Oui, monsieur Hitler", bredouilla sourdement Ward, et il continua son chemin. Mais l'homme blanc fit demi-tour, l'attrapa et lui fit faire volte-face :
"Qu'est-ce que tu viens de dire, con de nègre ?
- J'ai rien dit, répondit Ward. J'insultais seulement Hitler.
- Tu es un sacré menteur, rétorqua l'homme blanc hargneusement. Tu m'as appelé Hitler et j'accepte ça de personne."
Alors, il gifla Ward, qui lui rendit la pareille. L'autre homme blanc se précipita à la rescousse et Ward tira son couteau. La femme cria et Ward blessa légèrement l'homme blanc au bras. L'autre Blanc l'attrapa par-derrière; Ward se pencha en avant et, pivotant sur lui-même, l'envoya promener. Son premier adversaire revint à la charge et lui flanqua un coup de pied dans le ventre; Ward lui planta sa lame dans le cou. La femme continuait à hurler et, finalement, d'autres Blancs accourent qui maîtrisèrent ward.
Un agent de police arriva enfin, mais la foule était déjà trop dense pour qu'il pût la tenir en main. Il fit donc de son mieux et dit : "Ne le lynchez pas ici, faites-le sortir de la ville."
Mais les gens n'avaient pas envie de le lyncher. Les blessures des victimes étaient légères et, tout ce qu'ils voulaient, c'était lui donner une bonne leçon. Un homme qui avait une carte de rationnement fournit de l'essence et ils lui en arrosèrent les pieds; ils lui attachèrent les bras derrière le dos, mirent le feu à ses jambes et le relâchèrent. Il se mit à courir dans les rues, les pieds en flammes jusqu'à ce que ses chaussures aient complètement brûlé; ses pieds avaient enflé du double de leur taille normale et étaient couverts de cloques noirâtres. Il trouva un camion réfrigéré, grimpa péniblement dedans, plongea ses pieds dans la glace et s'évanouit.
Les gens riaient dans toute la rue.
Quinze jours plus tard, un médecin vint à la prison municipale où Ward purgeait une peine de quatre-vingt-dix jours pour agression à main armée - une peine très légère, avait déclaré le juge - et l'amputa des deux pieds.
Ward avait un frère dans la marine et un frère dans l'armée, il avait aussi un beau-frère qui travaillait dans les industries de la Défense nationale à Chicago. Ils se cotisèrent et lui envoyèrent assez d'argent pour aller à Chicago à sa sortie de prison.
Quand il fut libéré, des gens charitables de l'église lui donnèrent des béquilles, et quand il eut appris comment s'en servir un peu il prit le train pour Chicago. Là, sa soeur lui remit assez d'argent pour s'acheter des grenouillères en cuir. Il se trouva un boulot de cireur de chaussures; bref, tout allait bien pour lui.
Il avait acheté trois bons de la Défense nationale à vingt-cinq dollars et faisait des économies pour en acheter un quatrième.
Le film Bataan passait dans un cinéma du centre-ville cette semaine-là; et, un soir, Ward quitta tôt son boulot pour aller le voir. Il avait entendu parler de ce Noir, Mr. Spencer, qui jouait le rôle d'un soldat et il voulait voir lui-même ce que ça donnait. Il s'assit à la première place de la travée pour ne pas gêner les gens et glissa ses béquilles sous son siège. C'était un bon film et il lui plut beaucoup. Cela montre bien ce qu'un homme de couleur peut faire s'il consent l'effort voulu, pensait-il : il y a ce Mr. Spencer qui joue comme un vrai soldat, et il s'en tire aussi bien que les Blancs.
Mais, lorsque le film se termina, un énorme et superbe drapeau américain apparut sur l'écran et les accords émouvants de l'hymne national retentirent. Les spectateurs se levèrent d'un bond et se mirent à applaudir. Ward ne se leva pas.
Un Blanc, grand et fort, qui se tenait derrière lui se pencha et le frappa sur la tête.
"Lève-toi, mec, grogna-t-il. Qu'est-ce que tu as ? Tu ne reconnais pas l'hymne national, quand tu l'entends ?
- Je ne peux pas me lever, répondit Ward.
- Et pourquoi tu ne peux pas ?
- Je n'ai pas de pieds", lui dit Ward.
Pendant un instant, le Blanc resta là, debout, envahi d'une fureur rentrée, puis il prit du recul et cogna Ward sur le côté de la tête.
Ward tomba en avant, entre les deux travées de fauteuils, l'homme blanc se retourna et courut vers la sortie. Un agent qui se tenait dans le foyer et avait été témoin de l'incident rattrapa le Blanc tandis qu'il sortait de la salle.
"Je vous arrête. Qu'est-ce qui se passe, d'ailleurs ?
- Je n'ai pas pu m'en empêcher, bredouilla l'homme blanc, le visage inondé de larmes. Je ne vous comprends pas, vous, les gens de Chicago, je suis de l'Arkansas, je ne pouvais absolument pas supporter de voir ce sale nègre assis pendant qu'on jouait l'hymne national - même s'il n'a pas de pieds!"
"Il ne lui manque que les pieds"
Ward marchait sur le trottoir à Rome, en Georgie, lorsqu'il croisa une Blanche et deux hommes blancs : il descendit du trottoir pour les laisser passer.
Mais l'homme blanc le heurta quand même, puis se retourna pour lui dire :
"Qu'est-ce qui te prend, sale nègre, il te faut toute la rue ?
- Oh, écoutez, messieurs dames", commença Ward, mais l'homme blanc lui donna une bourrade :
"Allez, fous le camp, sale nègre, avant qu'il t'arrive des histoires.
- Oui, monsieur Hitler", bredouilla sourdement Ward, et il continua son chemin. Mais l'homme blanc fit demi-tour, l'attrapa et lui fit faire volte-face :
"Qu'est-ce que tu viens de dire, con de nègre ?
- J'ai rien dit, répondit Ward. J'insultais seulement Hitler.
- Tu es un sacré menteur, rétorqua l'homme blanc hargneusement. Tu m'as appelé Hitler et j'accepte ça de personne."
Alors, il gifla Ward, qui lui rendit la pareille. L'autre homme blanc se précipita à la rescousse et Ward tira son couteau. La femme cria et Ward blessa légèrement l'homme blanc au bras. L'autre Blanc l'attrapa par-derrière; Ward se pencha en avant et, pivotant sur lui-même, l'envoya promener. Son premier adversaire revint à la charge et lui flanqua un coup de pied dans le ventre; Ward lui planta sa lame dans le cou. La femme continuait à hurler et, finalement, d'autres Blancs accourent qui maîtrisèrent ward.
Un agent de police arriva enfin, mais la foule était déjà trop dense pour qu'il pût la tenir en main. Il fit donc de son mieux et dit : "Ne le lynchez pas ici, faites-le sortir de la ville."
Mais les gens n'avaient pas envie de le lyncher. Les blessures des victimes étaient légères et, tout ce qu'ils voulaient, c'était lui donner une bonne leçon. Un homme qui avait une carte de rationnement fournit de l'essence et ils lui en arrosèrent les pieds; ils lui attachèrent les bras derrière le dos, mirent le feu à ses jambes et le relâchèrent. Il se mit à courir dans les rues, les pieds en flammes jusqu'à ce que ses chaussures aient complètement brûlé; ses pieds avaient enflé du double de leur taille normale et étaient couverts de cloques noirâtres. Il trouva un camion réfrigéré, grimpa péniblement dedans, plongea ses pieds dans la glace et s'évanouit.
Les gens riaient dans toute la rue.
Quinze jours plus tard, un médecin vint à la prison municipale où Ward purgeait une peine de quatre-vingt-dix jours pour agression à main armée - une peine très légère, avait déclaré le juge - et l'amputa des deux pieds.
Ward avait un frère dans la marine et un frère dans l'armée, il avait aussi un beau-frère qui travaillait dans les industries de la Défense nationale à Chicago. Ils se cotisèrent et lui envoyèrent assez d'argent pour aller à Chicago à sa sortie de prison.
Quand il fut libéré, des gens charitables de l'église lui donnèrent des béquilles, et quand il eut appris comment s'en servir un peu il prit le train pour Chicago. Là, sa soeur lui remit assez d'argent pour s'acheter des grenouillères en cuir. Il se trouva un boulot de cireur de chaussures; bref, tout allait bien pour lui.
Il avait acheté trois bons de la Défense nationale à vingt-cinq dollars et faisait des économies pour en acheter un quatrième.
Le film Bataan passait dans un cinéma du centre-ville cette semaine-là; et, un soir, Ward quitta tôt son boulot pour aller le voir. Il avait entendu parler de ce Noir, Mr. Spencer, qui jouait le rôle d'un soldat et il voulait voir lui-même ce que ça donnait. Il s'assit à la première place de la travée pour ne pas gêner les gens et glissa ses béquilles sous son siège. C'était un bon film et il lui plut beaucoup. Cela montre bien ce qu'un homme de couleur peut faire s'il consent l'effort voulu, pensait-il : il y a ce Mr. Spencer qui joue comme un vrai soldat, et il s'en tire aussi bien que les Blancs.
Mais, lorsque le film se termina, un énorme et superbe drapeau américain apparut sur l'écran et les accords émouvants de l'hymne national retentirent. Les spectateurs se levèrent d'un bond et se mirent à applaudir. Ward ne se leva pas.
Un Blanc, grand et fort, qui se tenait derrière lui se pencha et le frappa sur la tête.
"Lève-toi, mec, grogna-t-il. Qu'est-ce que tu as ? Tu ne reconnais pas l'hymne national, quand tu l'entends ?
- Je ne peux pas me lever, répondit Ward.
- Et pourquoi tu ne peux pas ?
- Je n'ai pas de pieds", lui dit Ward.
Pendant un instant, le Blanc resta là, debout, envahi d'une fureur rentrée, puis il prit du recul et cogna Ward sur le côté de la tête.
Ward tomba en avant, entre les deux travées de fauteuils, l'homme blanc se retourna et courut vers la sortie. Un agent qui se tenait dans le foyer et avait été témoin de l'incident rattrapa le Blanc tandis qu'il sortait de la salle.
"Je vous arrête. Qu'est-ce qui se passe, d'ailleurs ?
- Je n'ai pas pu m'en empêcher, bredouilla l'homme blanc, le visage inondé de larmes. Je ne vous comprends pas, vous, les gens de Chicago, je suis de l'Arkansas, je ne pouvais absolument pas supporter de voir ce sale nègre assis pendant qu'on jouait l'hymne national - même s'il n'a pas de pieds!"