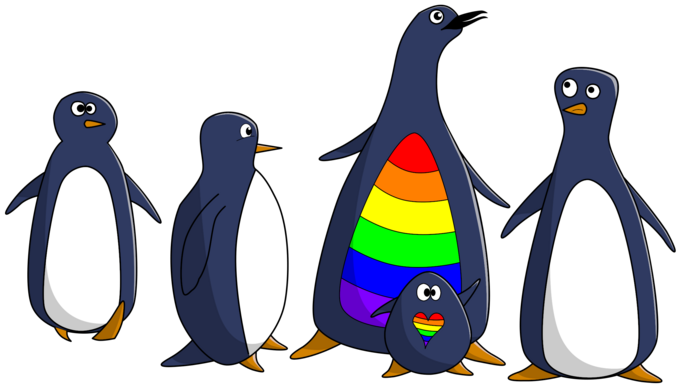Alexandra, c’est cette vieille femme russe à l’esprit vif mais au corps épuisé qui s’en va en Tchétchénie pour voir son petit fils Denis, officier dans une unité de combat. Arrivée dans un de ces campements comme il en existe tant mais refusant d’être confinée dans le miteux baraquement où on l’a installée – son « hôtel » - elle déambule dans la garnison et découvre petit à petit la vie misérable de ces enfants que la Mère Russie envoie au front pour mener une guerre qui ne devrait pas être. Opiniâtre comme pas deux, elle décide de s’affranchir du sans-grade que son petit fils lui avait laissé comme gardien et passe les barrières du campement afin d’aller en ville. Chez les tchétchènes, donc. Là, au milieu des immeubles éventrés par les obus et de la pauvreté, elle rencontre Malika, une vieille femme qui vend des cigarettes sur un stand d’un marché. La rencontre, émouvante, confortera Alexandra dans l’idée que rien ne distingue les russes des tchétchènes…

Plaidoyer intimiste pour la paix, Alexandra n’est pas un film politique : c’est une tranche de vie dont l’universalité est la force première. Le personnage éponyme, divinement interprété par l’ancienne soprano Galina Veshnevskaya est tout simplement bouleversant de vérité. Magnifiée par une réalisation d’orfèvre où les passages en sépia répondent aux portraits en clairs-obscurs, Alexandra déambule avec sa grâce maladroite dans la poussière soulevée par les blindés. Au-delà de l’héroïne anonyme et atypique d’une histoire en laquelle chacun pourra se reconnaître ( a fortiori si on a eu des rapports privilégiés ou forts avec sa grand-mère ), cette vieille femme est surtout le chantre de ces oubliés qui habitent aux portes de l’Europe. A travers elle, Sokurov donne un visage et une voix aux gamins-soldats, aux veuves de guerre et à toutes les autres victimes oubliées de la bêtise humaine. Sans jamais sombrer dans le pathos, le réalisateur, grandement aidé par l’admirable partition d’Andrei Sigle, signe ici un film poignant et qui, parce qu’il est ancré dans le vrai, ne peut s’achever sur un happy end…

Si tu devais demander quelque chose à dieu, demande lui l’intelligence.
La force n’est ni dans les mains, ni dans les armes.
Avant de conclure, j’aimerais que vous lisiez ces quelques mots du réalisateur, extraits du dossier de presse et d’une interview donnée aux Cahiers du cinéma :
Pour moi, cette histoire ne parle pas de l’actualité, mais de ce qui est éternel. La guerre est toujours quelque chose de terrible. Il n’y a pas de guerre dans ce film sur la guerre. Les opérations militaires sont rejetées hors du film. Je n’aime pas les films de guerre de fiction. Il me suffit d’avoir vu la guerre une fois pour que toutes ces attaques spectaculaires, ces explosions hautes en couleurs, ces corps tombant au ralenti évoquent définitivement pour moi l’idée de vulgarité et de faux. Il n’y a aucune poésie à la guerre, aucune beauté et il ne faut pas la filmer de manière poétique : cette horreur est inexprimable, comme est inexprimable l’humiliation de l’Homme. [...] Je sais les nombreux crimes et la dureté des hommes en temps de guerre. Mais cette guerre est terminée et nous devons revenir l’un vers l’autre, en respectant mutuellement les victimes. Nous avons fait ce film pour dire qu’il faut arrêter cette guerre, qu’elle est finie, que c’est un cauchemar qui doit prendre fin maintenant et qui ne doit pas recommencer. Dans notre film, nous cherchons des voies qui rapprochent les hommes – et nous les trouvons.
Alexandra est de ces films dont je ne suis pas sorti indemne, de ceux devant lesquels je n’ai pu réprimer mes larmes, de ceux qui m’ont fait mal et que j’ai revu et continuerai à revoir, encore et encore. Non pas par masochisme mais parce qu’il y a en eux une beauté, une force qui transcende la toile et en lesquels on se reconnaît. Un peu comme ces chansons tristes qui nous accompagnent et qu’on écoute parce qu’elle portent en elles nos souvenirs, bons et moins bons, et qu’en dépit de la peine qu’on éprouve, on y trouve une forme de consolation. Un mal réconfortant, en quelques sortes…
Le mot de la fin ? En ces temps de disgrâce cinématographique où la bêtise et la surenchère de violence gratuite sont loi, Sakurov replace l’Homme au cœur du propos et signe ici l’un des plus beaux et bouleversants films de l’année. Merci, monsieur Sokurov. Merci.
Ps 1 : désolé pour la qualité plus que moyenne de cette chronique mais je n’ai pas réussi à faire mieux.
Ps 2 : désolé de n’avoir pas pondu une chronique humoristique. La prochaine le sera.
Ps 3 : vu que j’ai adoré, vous allez détester.
Ps 4 : en dépit de ce que l'on peut penser à la lecture de cette chronique, je reste un sale connard.