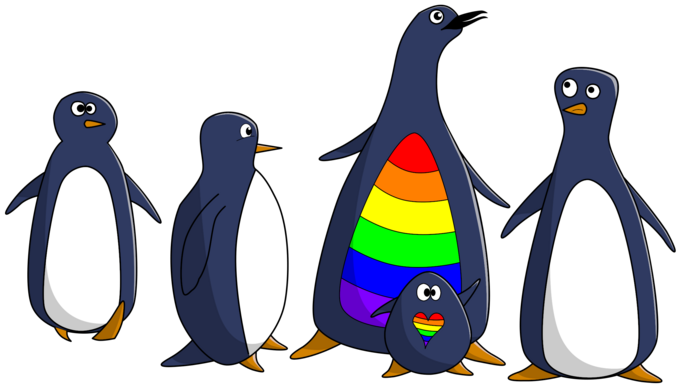|
Ce matin là encore, la ville étant prise par la neige depuis plusieurs semaines, j’avais été contrainte de me rendre à pieds sur mon lieu de travail. Engourdie par la chaleur du foyer, j’avais ouvert la lourde porte à double battants pour découvrir une rue silencieuse, inhabituellement déserte, et prise dans un brouillard blanc, immobile et sourd. J’amorçais un premier pas sur un sol recouvert d’une neige qui durant la nuit s’était mise à fondre, se grisant de tons saumâtres et inquiétants, transformant la sérénité du manteau blanc de la veille en tableau désolant. Au loin, on pouvait entendre une sirène étouffée. La lumière des lampadaires se frayait péniblement un chemin craintif au travers de l’humidité épaisse.
Il me fallait parcourir environ un kilomètre avant de rejoindre le tramway qui devait me conduire à destination. J’entamais donc la route, hésitant entre des trottoirs gelés et les caniveaux semi-boueux, écoutant mes pas produire un désagréable bruit de succion dans une fange crasseuse de monticules instables, ou un bruit de crissement suintant. Recouverte de mes vêtements d’hiver, j’entrapercevais d’autres passants, aux visages imperceptibles, cachés sous leurs bonnets de laine et leurs écharpes, silhouettes fragiles, patibulaires ou immobiles. J’évitais sur ma route un seau d’eau noirâtre jeté dans les égouts publics par les mains massives d’une ménagère, sortie surréaliste vêtue d’un invariable tablier à fleurs.
Arrivée à mon arrêt, je traversais les rails sombres afin de me placer du bon côté, et gratter du pied la couche de neige pour en mesurer l’épaisseur jusqu’à la dalle. Les autres passagers silencieux avaient une existence nimbée de mystère, comme avalés par un ciel lourd infiniment absorbant, impénétrable et maussade.
Les voitures sur la route attenante produisaient un vrombissement grave presque lointain, supplanté lentement par l’arrivée corpulente de la rame. Je me glissais dans le wagon pour échapper à l’emprise impalpable du givre, et m’asseyais péniblement en attendant le point d’arrivée. Mes compagnons de voyage, balancés au rythme des cahots avaient tous le visage gris et fatigué, absorbés qui par un livre, qui par sa musique, qui par les gouttelettes éparses trainées par le vent sur les vitres gelées. L’atmosphère taciturne était inhabituelle en ce lieu, chacun se recroquevillant sur soi pour limiter la perte de chaleur progressive et l’engourdissement. Aux arrêts, des passagers descendaient, et le bruit de la route progressivement cédait place au bercement éraillé du tram. Dehors, de grands corps d’arbres noirs se profilaient dans le brouillard insondable. Hypnotisée par la pâleur laiteuse environnante, je m’aperçus que j’avais raté ma sortie. Mais happée par une insidieuse somnolence, je me laissais conduire, indifférente. Je remarquais que les quelques silhouettes qui restaient autour de moi semblaient s’avachir sur elles mêmes, et que je n’en discernais plus les visages tant ils étaient masqués par leurs pesantes capuches grises. Je ne percevais plus qu’un dos, ou un profil. Peu à peu personne ne resta dans le wagon qui poursuivait sa route, nimbé de brume, sans perspective extérieure, et presque sans bruit.
Epuisée, je regardais le sol, vide et ruisselant, l’eau s’étalant lentement en rigoles hypnotiques, de plus en plus noires. Sur les parois aussi, un suintement épais et inquiétant se formait mollement recouvrant progressivement l’espace, et le bruit entêtant et sourd, se fondait dans cet écoulement paralytique écœurant. Je tentais de me relever, mais me sentis soudain désireuse d’abandonner, et de me laisser aller à cette absence de sensation, à ce flux noir imperturbable, et de m’endormir, dans une nuit impassible, recouvrant sans trace ni mot le monde avant qu’il ne s’oublie dans une page blanche.