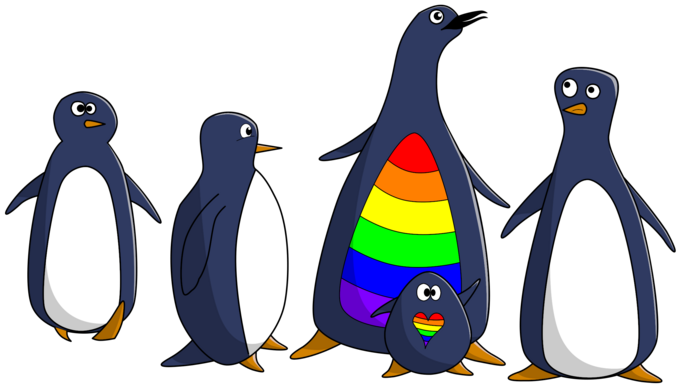Kefka a écrit :Oui, et ? Qu'est-ce qui empêche des croyants ne se reconnaissant pas l'Eglise de discuter entre eux de leur propre foi ?
Justement : au mieux peuvent-ils parler chacun de leur foi respective, mais ils ne peuvent pas
discuter d'une foi commune. Chacun étant libre de reprendre (ou non) les éléments apportés par les autres, chacun étant aussi libre de rejetter les critiques de l'autre comme infondées, il faut être capable d'une grande perspicacité et d'une grande lucidité pour ne pas tomber dans le dialogue de sourds...
Kefka a écrit :Et en fait, je doute que la foi se soumette à un traitement comme celui de la rationalité intersubjective, c'est faire là, à mon avis, une grave erreur de catégorie.
Pourrais-tu développer, s'il te plaît ? La foi, certainement pas vu sa nature toute personnelle, mais les jugements et le système de valeurs qui chercheront à s'appuyer sur elle, pourquoi pas ? Une qualité souvent mise en avant par les religions demande même d'examiner avec la plus extrême prudence toute réflexion née de la solitude : c'est l'humilité. (Zut, Mucho vient d'introduire l'idée de « modestie » avant moi...

)
Kefka a écrit :Au final, même si la source de la foi est intérieure (la "résonance" aux textes), les prescriptions qui en découlent et son juge sont, quant à elles, extérieures au sujet : le comportement en adéquation avec les valeurs est prescrit par les textes eux-mêmes et non par le sujet et le Dieu auquel le "je" crois n'est pas soi. C'est le principe même de l'autonomie : le sujet se donne les moyens de respecter ses propres lois (en l'occurrence, ses propres croyances). Et de fait, il ne relève pas du domaine de la foi que de respecter une autorité extérieure globale et de s'y tenir fidèle : n'est pas croyant celui qui fait parce qu'on lui a dit de faire ainsi et de respecter la "volonté" de Dieu. Encore est-il nécessaire de croire en cette "volonté" et en ces préceptes et de les vouloir quand bien même on sait qu'on échouera (parce qu'effectivement, on échouera, ce n'est même pas discutable).
C'est étrange, j'aurais plutôt tendance à dire l'exact inverse de toi. La source de la foi n'est pas intérieure : on ne décide pas d'avoir la foi. C'est un « fait », pour rebondir sur l'étymologie avancée par Mucho. Ce n'est pas pour rien que la Foi est rangée parmi les vertus théologales, c'est-à-dire celles qui ne peuvent s'obtenir que par la grâce de Dieu. Au contraire, le respect des prescriptions est,
in fine, une décision toute personnelle : même si elles sont données par les textes eux-même, il faut encore choisir de se soumettre à leur autorité. Contrairement à ce que tu avances, il me semble que l'on peut très bien considérer comme croyant quelqu'un qui « fait parce qu'on lui dit de faire », si du moins c'est sa foi et son humilité qui le conduisent à reconnaître ce « on » comme une autorité légitime. Celui qui se soumet à l'avis d'un prêtre pour une décision difficile, n'a-t-il pas commencé par
choisir d'aller lui demander son avis ?
Par ailleurs, je ne comprends pas ta dernière phrase.