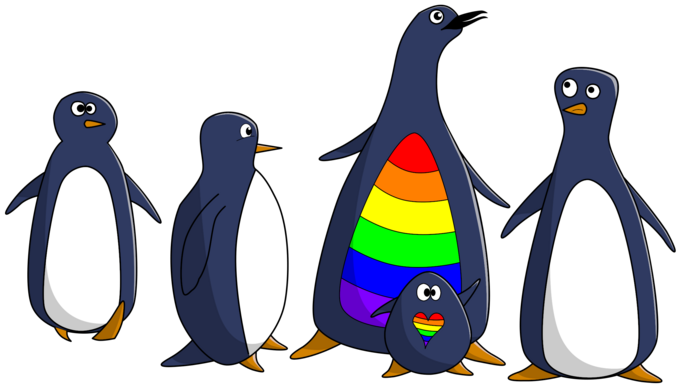tkf a écrit :J'ai l'impression que je commence à comprendre pourquoi notre débat tournait en rond : nous n'avons pas l'air d'avoir les mêmes paradigmes pour ce débat. C'était clair avec la définition du mot "créationnisme", mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un autre problème, celui que tu crois si j'ai bien compris que pour combattre le créationnisme il faille remettre en cause l'existance de Dieu (ou alors j'ai très mal lu entre les lignes).
Euh non

Je ne cherche pas à remettre en cause l'existence de Dieu. Dans la mesure où il s'agit d'une croyance, et dans une plus large mesure d'une conviction, j'ai le plus profond respect pour les croyants. Par extension, démonter le créationnisme en remettant en cause Dieu me paraît vain et inutile. Quand je suis intervenu dans le débat, l'opposition créationnisme/évolutionnisme s'était réduite à la portion congrue de croyants versus athées...

alors qu'il existe des croyants évolutionnistes et des athées créationnistes. Le débat me semblait prendre une direction tronquée, j'ai voulu redresser la barre. D'autre part, l'évolutionnisme s'appuie sur des faits quand le créationnisme s'appuie... s'appuie sur quoi en fait ?

Bref, les 2 n'ayant pas le même référentiel, il me semble également délicat d'opposer les 2.
tkf a écrit :En imaginant que je ne me suis pas trompé dans ce que tu présupposes, je répondrai par la négative, puisque comme tu l'as très bien dis la science ne peut pour l'instant prouver ni son existance ni son inexistance. cela est donc inutile.
Exact !

tkf a écrit :Non, pour combattre le créationnisme, il faut plutôt, en plus d'apporter des éléments scientifiques sur l'évolution, critiquer les textes sacrés. C'est absolument nécessaire. Je m'explique:
Lisons
tkf a écrit :Tu as hier mal compris mes propos : ce ne sont pas mes élèves qui écrivent sur leur copie qu'ils ne croient pas à l'évolution. Ces faits sont rapportés dans des articles de presse. Ces incidents se produisent en cours de SVT, logique, car l'évolution est abordée uniquement à la base officiellement dans cette matière. Et c'est donc là le problème : le cours de SVT apporte des éléments scientifiques, auquels certains élèves offrent une résistance acharnée. Pourquoi ? Parce que cela entre en contradiction avec les textes sacrés. Or, durant le cours de SVT, on n'étudie pas ces textes sacrés, donc l'élève peut se conforter en disant, et c'est humain : j'ai deux sources d'informations contradictoires, je choisis celle qui me convient le mieux. Les scientifiques font exactement la même chose lorsqu'ils sont en présence de deux théories scientifiques contradictoires : il font un choix en fonction de leur conviction personnelle. Bref, informer les gens sur la théorie de l'évolution est une mission d'éducation, d'information, mais pas forcément de persuasion.
OK pour les cours de SVT que tu viens de raconter. Pas d'accord pour le soit-disant scientifique qui ferait un choix en fonction de sa conviction personnelle. La science est suffisamment rigoureuse, factuelle et objective pour justement s'affranchir des convictions personnelles (donc subjectives) dans l'orientation d'un choix, l'organisation d'une conclusion, ou encore la démonstration d'une théorie. La science est objective, elle ne laisse pas la place à la subjectivité.
A titre personnel, je vois une faille dans ce que tu écris quand tu expliques que l'élève, entre 2 théories contradictoires, il choisira ce qui lui convient le mieux. L'évolution est une théorie, le créationnisme est un dogme. Il faudrait peut-être commencé par expliquer ce qu'est un dogme, ce qu'est une preuve, comment fonctionne la science. Voilà les bases nécessaires pour fournir un libre arbitre suffisant à l'élève et ainsi l'aider à faire la différence entre ce que propose la science et ce que propose sa religion.
tkf a écrit :Par contre, dans une démarche historique, comme je le fais en classe, là cela marche beaucoup mieux, car je ne me contente pas d'apporter des éléments scientifiques sur l'évolution, je fais avec les élèves un travail de critique historique des textes, ce qui permet de montrer que les gens ne doivent pas prendre tout littéralement dans la Bible comme argent comptant (dont les mythes de la création de la Terre et de l'Humanité), mais qu'il est nécessaire de prendre du recul pour en comprendre le sens réel (les fameuses allégories). Ce travail de recherche, de critique de l'information, de relativisation, de mise en perspective, dans le contexte de l'époque de la rédaction, est à la base une aide pour former un citoyen autonome et responsable. Mais cela permet aussi au bout du compte de permettre aux personnes d'être mieux renseigné pour faire un choix entre les deux concepts du créationnisme et de l'évolution. Au passage, ce travail ne remet pas en cause la foi. Enfin pas forcément.
Tout à fait d'accord

Tu fais ainsi appel (ou tu le développes plutôt) au libre arbitre de tes élèves en développant leur esprit critique et en leur donnant les outils nécessaires pour leur permettre de réaliser, comprendre et considérer dans quel contexte historique ont été rédigés les textes sacrés. Et là encore je te rejoins

tout se fait dans le respect des convictions de chacun, en particulier ici la Foi!
tkf a écrit :Les protestations virulentes que j'ai pu avoir en classe ne se produisaient jamais à la fin mais pendant le chapitre en cours : normal, c'est la première fois qu'ils entrent en contact avec la critique historique. Mais en règle générale, les élèves finissent par bien comprendre la nécessaire mise en perspective historique des textes sacrés. Et en toute circonstance, pas seulement en terme de créationnisme.
Merci, tu formes ainsi des futures personnes qui pourront faire appel à leur sens critique et à leur libre arbitre (s'ils ne sont pas trop ensuite endoctrinés

) pour faire leur choix.
tkf a écrit :Rappelons à l'inverse que les fondamentalistes créationnistes se contentent le plus souvent de dire : croyez-nous, ayez la foi. Certes, il y a des tentatives de légitimation scientifique, mais elles manquent cruellement d'arguments valables. J'ai pu le constater en regardant il y a quelques années un documentaire pro-créationniste arabe sur une chaine algérienne. leur méthode c'est : la science ne parvient pas à expliquer cela, ou c'est écrit çà dans la Bible, donc la théorie de l'évolution est fausse. Superbe démonstration. Mais cela est suffisant pour beaucoup de personnes qui ne remettent pas en cause les informations qu'ils ingurgitent par absence de sens critique.
Et oui

la crédulité a encore de beaux jours devant elle

Du coup les prosélytes ont encore de beaux jours devant eux

Mais quand on y regarde de plus près, l'Eglise, ou toute autre forme d'organisation religieuse, a toujours maintenu le plus grand nombre dans l'ignorance pour mieux les maitriser, pour mieux les asservir. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui les intégristes traditionalistes catholiques sont par exemple farouchement et viscéralement opposés à la liberté d'expression

Ce n'est pas pour rien que ces mêmes ultra catho tradi prônent pour un retour rapide de la femme au foyer sous le joug de son mari !
tkf a écrit :Il n'y a que par la critique historique et donc scientifique des textes sacrés que l'on put permettre à des gens à devenir plus autonomes et d'être moins crédules.
Je ne vois pas le lien entre critique historique qui induirait une critique scientifique. D'autant plus que dans ton explication, tu fais surtout mention à la remise dans son contexte la rédaction des textes. Je ne vois là aucune critique scientifique.
Comment critiquer scientifiquement l'inexistence d'Adam et Eve ?!?



Comment critiquer scientifiquement l'inexistence d'un dessein intelligent ?!?


Comment critiquer scientifiquement la non intervention d'un concepteur dans l'apparition de la vie sur Terre ?!?



Je rejoins Fade Out sur une de ses phrases en me permettant de substituer sa fin : la science est parfaitement incapable de démontrer l'inexistence de quelque chose qui repose exclusivement sur des convictions, sur la Foi, sur des dogmes.