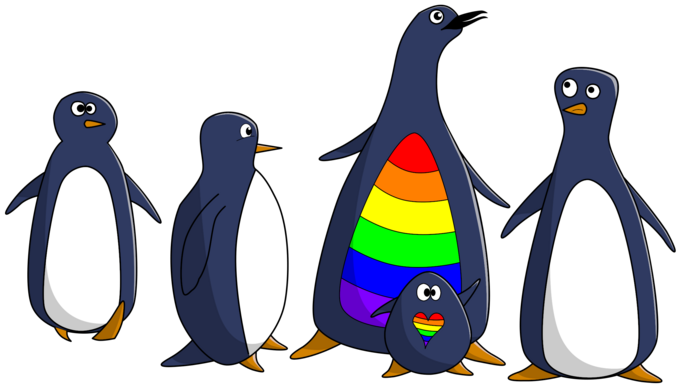Je connais mal encore Aides. Le peu que j'en connais m'a posé questions. Peut-être que qqn-e pourra compléter mes débuts de réponses sans doute maladroits.
Tous les salariés ici sont gays, il n'y aucune femme. Parmi les volontaires, il n'y a pas de personnes trans. Je sais que les populations les plus touchées sont les gays (les hommes donc) et les personnes migrantes (hommes et femmes), ils forment d'ailleurs la majorité des personnes volontaires. Pourtant, il me semble qu'il serait aussi important d'avoir une communication spécifique envers les personnes trans qui ne sont pas accessibles dans les lieux gays et pour cause, il existe une forte transphobie chez les gays. Il serait intéressant aussi d'aller vers les personnes bisexuelles (pouvant contaminer des femmes hétéros loin d'y penser ou des lesbiennes - apparemment, le risque du SIDA d'après ce que j'ai entendu ne concerne pas du tout les lesbiennes... (ah...?)).
Je me suis demandée si les recruteurs de volontaires visaient juste ce dont ils avaient "besoin", sans chercher à se rallier d'autres publics "statistiquement" moins touchés par le SIDA. Ou bien, on pourrait penser que les publics moins touchés sont moins présents par la logique du nombre. mais là, je crois qu'ils sont carrément absents. Peut être qu'ils ne se sentent vraiment pas concernés... mmm...
en fait, je ne me suis pas sentie à ma place n'étant ni pd, ni d'origine africaine (bien qu'ayant accompagné des migrants, je connais un peu les personnes, mais je ne me suis définitivement pas sentie à l'aise).
AIDES
je connais aussi AIDES, mais bon ils doivent différer selon les régions et le personnel... de mon expérience, ce que je peux en dire.. les volontaires sont souvent des hommes, ca doit être un peu historique, le sida ayant d'abord touché les homos, les pédés se sont emparés de ce "problème" et c'est vrai pour l'instant personne n'a pu prouver de façon certaine la transmission de femme a femme, mais le principe de précaution existe (aides a sorti une sorte de "bible" du sida, je ne me souviens plus du nom mais vous trouverez toutes les statistiques..) tu peux trouver souvent des jeunes femmes, mais la rotation est grande, d'un fait tout simple, elles sont quasiment toutes hétéros, c'est pour elle une action de bénévolat, l'enjeu pour elle n'est pas le même, et puis la cohabitation hommes, femmes et peut être difficile parfois...et aussi une femme séropo ou travaillant dans aides doit assumer plus difficilement ce rôle, parce que parfois les gens vont "coller" certains stéréotypes aux femmes...
il y a aussi un phénoméne plus simple souvent les 1éres fois que un séropo vient a aides, il a des envies de volontariat, les raisons sont variés, aider les autres c'est s'aider soi même, aider c'est oublier sa situation, et du fait d'une certaine connotation aides-act up=pédés, il n'y a pas assez d'hétéro, les pédés oui, des bis, mais peu d'hétéro, j'ai eu des soirées apéro avec pas mal de bi, mais ce genre de soirées étaient résérvé au séropo et aucune "note" ne devaient sortir de ses soirées, elles étaient juste pour nous... donc ses personnes tu les retrouvent dans les volontaires...par contre peut être dans ta "région" ils s'organisent autrement mais de par chez moi, il existe une sorte de calendrier, chaque jour est consacré a une population... par exemple le lundi c'était la journée séropo, le mardi toxico, etc... mais pas de trans...
il existe aussi une politique, viser les populations les + a risques du moment, les migrants, et les gays... les trans sont un public plus difficile a cibler, comme tu le dis il existe une transphobie, tout le monde connait les lieux de dragues des pédés, tu peux t'inviter a une soirée, ou une boite pour les hétéros mais les trans ou tu les rencontres... si tu met en place une journée trans pas sur qu'elles viennent... par exemple la journée du lundi séropo était un échec personne ne venait...
je crois qu'il faut que tu cible tes envies, aides a pas mal d'activités paralléles, qui vont de l'aide social (exclusion, R.S.A, stages de ressourcement..), au simple accompagnement, a l'aide personnel aux malades... il faut être motivé, et savoir dans quoi t'engager, et ne t'inquiéte pas si tu t'es pas senti a ta place, c'est normal, n'oublie pourquoi les gens sont là, on parle du sida, c'est une sorte de mot "magique" ou tout doit rester cacher, les gens sont devenus méfiants et puis des personnes voulant devenir volontaires, qui n'ont pas fait de suite, j'en ai vu beaucoup....
il y a aussi un phénoméne plus simple souvent les 1éres fois que un séropo vient a aides, il a des envies de volontariat, les raisons sont variés, aider les autres c'est s'aider soi même, aider c'est oublier sa situation, et du fait d'une certaine connotation aides-act up=pédés, il n'y a pas assez d'hétéro, les pédés oui, des bis, mais peu d'hétéro, j'ai eu des soirées apéro avec pas mal de bi, mais ce genre de soirées étaient résérvé au séropo et aucune "note" ne devaient sortir de ses soirées, elles étaient juste pour nous... donc ses personnes tu les retrouvent dans les volontaires...par contre peut être dans ta "région" ils s'organisent autrement mais de par chez moi, il existe une sorte de calendrier, chaque jour est consacré a une population... par exemple le lundi c'était la journée séropo, le mardi toxico, etc... mais pas de trans...
il existe aussi une politique, viser les populations les + a risques du moment, les migrants, et les gays... les trans sont un public plus difficile a cibler, comme tu le dis il existe une transphobie, tout le monde connait les lieux de dragues des pédés, tu peux t'inviter a une soirée, ou une boite pour les hétéros mais les trans ou tu les rencontres... si tu met en place une journée trans pas sur qu'elles viennent... par exemple la journée du lundi séropo était un échec personne ne venait...
je crois qu'il faut que tu cible tes envies, aides a pas mal d'activités paralléles, qui vont de l'aide social (exclusion, R.S.A, stages de ressourcement..), au simple accompagnement, a l'aide personnel aux malades... il faut être motivé, et savoir dans quoi t'engager, et ne t'inquiéte pas si tu t'es pas senti a ta place, c'est normal, n'oublie pourquoi les gens sont là, on parle du sida, c'est une sorte de mot "magique" ou tout doit rester cacher, les gens sont devenus méfiants et puis des personnes voulant devenir volontaires, qui n'ont pas fait de suite, j'en ai vu beaucoup....
pour compléter ce qui avait déja été évoqué.. ne sachant ou le mettre pour ne pas créer une autre polémique... a vous de voir si il doit être modérer ou pas...
Rapport de la Mission RDRs
Un rapport qui engage la prévention en France dans de nouvelles directions
Le Rapport de la Mission RDRs a été rendu public ce matin lors de la conférence de presse de Roselyne Bachelot. 98 recommandations, 63 pages en version courte, un nombre impressionnant d'auditions (12 associations, 55 experts associatifs et scientifiques), 75 sites internet visités, 350 références bibliographiques. C'est du lourd. En voici les principaux points.
"Face aux nouveaux enjeux posés par l’épidémie à VIH chez les gays/HSH en France, la réponse associative et institutionnelle est trop longtemps restée paralysée par des controverses sur les approches de réduction des risques. Il n’est plus possible de demeurer dans une situation figée, préjudiciable en premier lieu aux personnes les plus concernées." La sentence est tombée. Les rapporteurs de la "Mission RDRs, de prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST" ne peuvent pas être plus clairs. Ils disent oui aux nouvelles méthodes de prévention qu'il faut promouvoir de manière combinée à l'usage du préservatif.
La lecture du Rapport n'est pas toujours aisée. Il faut tenir compte du passif entre les acteurs en opposition depuis plusieurs années sur le sujet, de la demande de la ministre d'avoir ce rapport rapidement pour le 1er décembre. Au final, on peut avoir le sentiment d'un inventaire à la Prévert, d'une prudence excessive qui ménage certains acteurs. Reste qu'un sentiment général se dégage en faveur d'un engagement net à sortir des schémas figés pour promouvoir les "nouvelles" techniques de prévention, avec et au côté de la promotion du préservatif.
Le préservatif reste "le socle" de la prévention du VIH, mais il doit désormais cohabiter
Cette norme, l'usage du préservatif lors des relations sexuelles, doit donc s'articuler "avec d'autres méthodes de réductions des risques (Prophylaxie Post Exposition, traitement antirétroviral, communication explicite entre partenaires, stratégies sero- adaptatives)". Si le préservatif reste le socle de la prévention du VIH, il ne doit plus être l'unique méthode promue. On s'oriente donc vers une "prévention combinée" où coexisteraient diverses méthodes pour augmenter "le niveau de protection face à l'hétérogénéité des risques et aux besoins des personnes concernées".
Le traitement comme outil de prévention et la question de la charge virale
Sur ce point, la Mission RDRs confirme clairement l'avis du Conseil national du sida. "Nous considérons [...] qu'un traitement efficace réduit le risque de transmission VIH". La Mission va même plus loin avec la recommandation 64 et l'on peut dire alors que l'avis suisse porté par Bernard Hirschel (2008) est désormais clairement entériné : "Dans les relations stables, entre personnes sérodifférentes ou séroconcordantes, nous préconisons de prendre en compte l’indétectabilité de la charge virale comme une méthode supplémentaire et efficace de réduction des risques lorsque le préservatif n’est pas utilisé. En contexte de relation non exclusive, nous recommandons le dépistage régulier des IST et l’usage systématique du préservatif avec les partenaires occasionnels." Outre l'avantage qu'il a à réduire la transmissibilité, le traitement comme outil préventif améliore la qualité de vie des personnes séropositives. En effet, pour la Mission, "la peur de transmettre a été de longue date identifiée comme centrale dans l'expérience des personnes séropositives, renforcée par la menace culpabilisante du discours prévention". Les stratégies préventives disponibles et notamment le traitement antirétroviral "apportent aujourd'hui des réponses supplémentaires aux besoins spécifiques" des séropositifs.
En conséquence, la Mission revient sur les recommandations actuelles 2008 de mise sous traitement et pour elle, "le traitement ARV au niveau individuel [...] devrait pouvoir être initié pour des raisons préventives : personnes ayant un comportement à risque élevé, désir de procréation".
Enfin, "le rôle des médecins spécialistes VIH" est réaffirmé dans "l'information des personnes atteintes en matière de prévention". La Mission considère que la préoccupation préventive est à ce jour "clairement insuffisante chez les médecins", et la "teneur des contenus préventifs" trop hétérogène.
Toutefois la portée prévention du traitement est "limitée par l'association entre VIH et IST" dans les populations où les IST sont très présentes. Car les IST peuvent favoriser la transmission du VIH, considère la Mission. Il est donc important de "renforcer la nécessité de promouvoir, seul ou combiné, le préservatif". C'est là où cela devient compliqué et là où le rapport tangue un peu. Par ailleurs, dans les couples où les partenaires sont séropositifs, il est nécessaire d'après la Mission de renforcer les compétences qui "impliquent la capacité de réintroduire le préservatif lorsque c'est nécessaire", par exemple en cas de problème d'observance ou d'échappement virologique.
Le risque de surcontamination, souvent sujet de polémiques
La Mission considère qu'il existe un "risque probablement faible de sur-infection dont les personnes séropositives doivent être informées". C'est pourquoi "les personnes en couple séro-concordants et viro-concordants, doivent être encouragées à utiliser le préservatif dans les rapports en dehors du couple et à se protéger dans le couple en cas d’échappement virologique d’un des partenaires."
Des recommandations sur certaines techniques mêmes de réduction des risques
Outre l'usage du préservatif, le traitement en prévention, la Mission s'est penchée sur d'autres techniques comme la séroadaptation (serosorting), la sécurité négociée, le seropositionning et le retrait avant éjaculation. Ces pratiques de réductions des risques qui ont longtemps suscité polémiques entre associations et des indécisions de la part des autorités de santé publique, sont mis en œuvre depuis plusieurs années par certains gays et ont été décrites dans différentes études scientifiques à l'étranger.
Sur le serosorting, définie par la Mission comme le "choix du partenaire et/ou des pratiques sexuelles (oral, anal, réceptif, insertif, éjaculation ou non…) en fonction du statut sérologique", la Mission ne se prononce pas clairement étant donné le manque d'études en France sur le sujet. Dans ce contexte, elle considère que "la réduction du nombre de pénétrations anales non protégées avec des partenaires occasionnels demeure un objectif majeur". Elle insiste sur le besoin "entre partenaires occasionnels séropositifs ou présumés tels "de faciliter les conditions du dévoilement du statut sérologique". Elle ne va pas plus loin sur la relation entre dévoilement du statut et séroadaptation.
Elle juge qu'entre partenaires occasionnels séronégatifs ou présumés tels, le serosorting "entre séronégatifs n'est efficace que dans les relations stables connaissant mutuellement leur statut après un test de dépistage". Ce qui implique la promotion d'un dépistage répété annuellement ou "autant que nécessaire". En dehors de cette situation, l'utilisation du préservatif "est la seule protection efficace". La Mission insiste sur le besoin "d'approfondir la connaissance de la diversité des stratégies/comportements mis en œuvre en fonction du statut sérologique perçu ou connu du partenaire, stable ou occasionnel".
Pour les approches préventives qui concernent des pratiques sexuelles, la Mission considère que " le retrait [avant éjaculation] lors de pénétrations anales non protégées peut être utile à des couples sérodifférents, quand les partenaires sont d’accord pour l’utiliser, y compris pour les relations bucco-génitales. Le retrait lors des rapports de fellation constitue un outil possible de RDRs en l’absence de préservatif. Il implique un dépistage régulier des IST et des lésions buccales."
Quant au "seropositionning" ou, quand le partenaire séronégatif est insertif et le partenaire séropositif est réceptif, la Mission estime que "pratiqué de manière exclusive, le seropositioning offre une protection significative vis-à-vis du VIH pour les hommes séronégatifs [...] renforcée par le fait d’être circoncis. " Elle recommande donc que "lors des pénétrations anales, le seropositioning [puisse] être envisagé comme une méthode permettant de limiter le risque d’infection par le VIH en l’absence d’utilisation du préservatif. Le dépistage régulier des IST est une condition fondamentale de sa pratique comme stratégie de réduction des risques."
La circoncision est donc aussi évoquée. La Mission prend en compte les études faites en Afrique Sub-Saharienne qui ont montré une efficacité (60% de réduction de la transmission de la femme à l'homme). Elle suggère que soit étudiée la possibilité de "prise en charge par l’Assurance Maladie de la circoncision médicalisée à la naissance ou plus tard".
Cette liste importante de recommandations montre l'étendue du champ d'action du Rapport, à la fois sur les pratiques possibles de réduction des risques, les besoins en recherche ou encore la nécessité d'adapter, même de revoir les dispositifs actuels comme celui associé à la prophylaxie post-exposition (PEP) : "La tonalité qui entoure en 2009 la PEP est encore dominée par la crainte de l’abus et de la surprescription alors qu’on observe dans la réalité plutôt une mauvaise connaissance aussi bien en population générale que chez les séropositifs dont les partenaires négatifs sont des candidats principaux au bénéfice de ce traitement." "Parmi les personnes séropositives enquêtées en 2003, 30 % n’avaient jamais entendu parler de la PEP."
Enfin au vu de l'impact majeur de l'épidémie VIH chez les homosexuels depuis des années, la Mission propose la création de centres de santé sexuelle LGBT aptes à offrir prévention, dépistage, traitement du VIH et des IST pour les gays, bi et transgenres. Car l'accès aux soins nécessaire pour ces populations est considéré comme insuffisant, "faute de connaissances de la part des professionnels", de "services capables de réaliser les actes nécessaires" et "en raison d'attitudes négatives" des professionnels de santé face aux LGBT.
Mise en ligne le 7/12/2009 - Source Seronet.info
Rapport de la Mission RDRs
Un rapport qui engage la prévention en France dans de nouvelles directions
Le Rapport de la Mission RDRs a été rendu public ce matin lors de la conférence de presse de Roselyne Bachelot. 98 recommandations, 63 pages en version courte, un nombre impressionnant d'auditions (12 associations, 55 experts associatifs et scientifiques), 75 sites internet visités, 350 références bibliographiques. C'est du lourd. En voici les principaux points.
"Face aux nouveaux enjeux posés par l’épidémie à VIH chez les gays/HSH en France, la réponse associative et institutionnelle est trop longtemps restée paralysée par des controverses sur les approches de réduction des risques. Il n’est plus possible de demeurer dans une situation figée, préjudiciable en premier lieu aux personnes les plus concernées." La sentence est tombée. Les rapporteurs de la "Mission RDRs, de prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST" ne peuvent pas être plus clairs. Ils disent oui aux nouvelles méthodes de prévention qu'il faut promouvoir de manière combinée à l'usage du préservatif.
La lecture du Rapport n'est pas toujours aisée. Il faut tenir compte du passif entre les acteurs en opposition depuis plusieurs années sur le sujet, de la demande de la ministre d'avoir ce rapport rapidement pour le 1er décembre. Au final, on peut avoir le sentiment d'un inventaire à la Prévert, d'une prudence excessive qui ménage certains acteurs. Reste qu'un sentiment général se dégage en faveur d'un engagement net à sortir des schémas figés pour promouvoir les "nouvelles" techniques de prévention, avec et au côté de la promotion du préservatif.
Le préservatif reste "le socle" de la prévention du VIH, mais il doit désormais cohabiter
Cette norme, l'usage du préservatif lors des relations sexuelles, doit donc s'articuler "avec d'autres méthodes de réductions des risques (Prophylaxie Post Exposition, traitement antirétroviral, communication explicite entre partenaires, stratégies sero- adaptatives)". Si le préservatif reste le socle de la prévention du VIH, il ne doit plus être l'unique méthode promue. On s'oriente donc vers une "prévention combinée" où coexisteraient diverses méthodes pour augmenter "le niveau de protection face à l'hétérogénéité des risques et aux besoins des personnes concernées".
Le traitement comme outil de prévention et la question de la charge virale
Sur ce point, la Mission RDRs confirme clairement l'avis du Conseil national du sida. "Nous considérons [...] qu'un traitement efficace réduit le risque de transmission VIH". La Mission va même plus loin avec la recommandation 64 et l'on peut dire alors que l'avis suisse porté par Bernard Hirschel (2008) est désormais clairement entériné : "Dans les relations stables, entre personnes sérodifférentes ou séroconcordantes, nous préconisons de prendre en compte l’indétectabilité de la charge virale comme une méthode supplémentaire et efficace de réduction des risques lorsque le préservatif n’est pas utilisé. En contexte de relation non exclusive, nous recommandons le dépistage régulier des IST et l’usage systématique du préservatif avec les partenaires occasionnels." Outre l'avantage qu'il a à réduire la transmissibilité, le traitement comme outil préventif améliore la qualité de vie des personnes séropositives. En effet, pour la Mission, "la peur de transmettre a été de longue date identifiée comme centrale dans l'expérience des personnes séropositives, renforcée par la menace culpabilisante du discours prévention". Les stratégies préventives disponibles et notamment le traitement antirétroviral "apportent aujourd'hui des réponses supplémentaires aux besoins spécifiques" des séropositifs.
En conséquence, la Mission revient sur les recommandations actuelles 2008 de mise sous traitement et pour elle, "le traitement ARV au niveau individuel [...] devrait pouvoir être initié pour des raisons préventives : personnes ayant un comportement à risque élevé, désir de procréation".
Enfin, "le rôle des médecins spécialistes VIH" est réaffirmé dans "l'information des personnes atteintes en matière de prévention". La Mission considère que la préoccupation préventive est à ce jour "clairement insuffisante chez les médecins", et la "teneur des contenus préventifs" trop hétérogène.
Toutefois la portée prévention du traitement est "limitée par l'association entre VIH et IST" dans les populations où les IST sont très présentes. Car les IST peuvent favoriser la transmission du VIH, considère la Mission. Il est donc important de "renforcer la nécessité de promouvoir, seul ou combiné, le préservatif". C'est là où cela devient compliqué et là où le rapport tangue un peu. Par ailleurs, dans les couples où les partenaires sont séropositifs, il est nécessaire d'après la Mission de renforcer les compétences qui "impliquent la capacité de réintroduire le préservatif lorsque c'est nécessaire", par exemple en cas de problème d'observance ou d'échappement virologique.
Le risque de surcontamination, souvent sujet de polémiques
La Mission considère qu'il existe un "risque probablement faible de sur-infection dont les personnes séropositives doivent être informées". C'est pourquoi "les personnes en couple séro-concordants et viro-concordants, doivent être encouragées à utiliser le préservatif dans les rapports en dehors du couple et à se protéger dans le couple en cas d’échappement virologique d’un des partenaires."
Des recommandations sur certaines techniques mêmes de réduction des risques
Outre l'usage du préservatif, le traitement en prévention, la Mission s'est penchée sur d'autres techniques comme la séroadaptation (serosorting), la sécurité négociée, le seropositionning et le retrait avant éjaculation. Ces pratiques de réductions des risques qui ont longtemps suscité polémiques entre associations et des indécisions de la part des autorités de santé publique, sont mis en œuvre depuis plusieurs années par certains gays et ont été décrites dans différentes études scientifiques à l'étranger.
Sur le serosorting, définie par la Mission comme le "choix du partenaire et/ou des pratiques sexuelles (oral, anal, réceptif, insertif, éjaculation ou non…) en fonction du statut sérologique", la Mission ne se prononce pas clairement étant donné le manque d'études en France sur le sujet. Dans ce contexte, elle considère que "la réduction du nombre de pénétrations anales non protégées avec des partenaires occasionnels demeure un objectif majeur". Elle insiste sur le besoin "entre partenaires occasionnels séropositifs ou présumés tels "de faciliter les conditions du dévoilement du statut sérologique". Elle ne va pas plus loin sur la relation entre dévoilement du statut et séroadaptation.
Elle juge qu'entre partenaires occasionnels séronégatifs ou présumés tels, le serosorting "entre séronégatifs n'est efficace que dans les relations stables connaissant mutuellement leur statut après un test de dépistage". Ce qui implique la promotion d'un dépistage répété annuellement ou "autant que nécessaire". En dehors de cette situation, l'utilisation du préservatif "est la seule protection efficace". La Mission insiste sur le besoin "d'approfondir la connaissance de la diversité des stratégies/comportements mis en œuvre en fonction du statut sérologique perçu ou connu du partenaire, stable ou occasionnel".
Pour les approches préventives qui concernent des pratiques sexuelles, la Mission considère que " le retrait [avant éjaculation] lors de pénétrations anales non protégées peut être utile à des couples sérodifférents, quand les partenaires sont d’accord pour l’utiliser, y compris pour les relations bucco-génitales. Le retrait lors des rapports de fellation constitue un outil possible de RDRs en l’absence de préservatif. Il implique un dépistage régulier des IST et des lésions buccales."
Quant au "seropositionning" ou, quand le partenaire séronégatif est insertif et le partenaire séropositif est réceptif, la Mission estime que "pratiqué de manière exclusive, le seropositioning offre une protection significative vis-à-vis du VIH pour les hommes séronégatifs [...] renforcée par le fait d’être circoncis. " Elle recommande donc que "lors des pénétrations anales, le seropositioning [puisse] être envisagé comme une méthode permettant de limiter le risque d’infection par le VIH en l’absence d’utilisation du préservatif. Le dépistage régulier des IST est une condition fondamentale de sa pratique comme stratégie de réduction des risques."
La circoncision est donc aussi évoquée. La Mission prend en compte les études faites en Afrique Sub-Saharienne qui ont montré une efficacité (60% de réduction de la transmission de la femme à l'homme). Elle suggère que soit étudiée la possibilité de "prise en charge par l’Assurance Maladie de la circoncision médicalisée à la naissance ou plus tard".
Cette liste importante de recommandations montre l'étendue du champ d'action du Rapport, à la fois sur les pratiques possibles de réduction des risques, les besoins en recherche ou encore la nécessité d'adapter, même de revoir les dispositifs actuels comme celui associé à la prophylaxie post-exposition (PEP) : "La tonalité qui entoure en 2009 la PEP est encore dominée par la crainte de l’abus et de la surprescription alors qu’on observe dans la réalité plutôt une mauvaise connaissance aussi bien en population générale que chez les séropositifs dont les partenaires négatifs sont des candidats principaux au bénéfice de ce traitement." "Parmi les personnes séropositives enquêtées en 2003, 30 % n’avaient jamais entendu parler de la PEP."
Enfin au vu de l'impact majeur de l'épidémie VIH chez les homosexuels depuis des années, la Mission propose la création de centres de santé sexuelle LGBT aptes à offrir prévention, dépistage, traitement du VIH et des IST pour les gays, bi et transgenres. Car l'accès aux soins nécessaire pour ces populations est considéré comme insuffisant, "faute de connaissances de la part des professionnels", de "services capables de réaliser les actes nécessaires" et "en raison d'attitudes négatives" des professionnels de santé face aux LGBT.
Mise en ligne le 7/12/2009 - Source Seronet.info
Aides
association connu surtout pour la lutte contre les IST et la prevention contre ses maladies , et l'aide aux personnes atteinte de ses maladies , ont aussi des antennes dans divers departements proposant des ateliers, des petits groupes de partages autour de divers themes,
par exemple dans l'essonne c'est une séance de massage , parlant en même tant de sujets divers et varié, sympa , juste que du massage, avec une personne qui vient pour nous guidé , je mes l'info car ce coté là est peu connu et peu merité le detour .
Edit: sorry pas bien cherché je voulais surtout mettre en lumiere un coté peu connu de aides sur des activités local apres pour ma place , je suis hypo sexuel , je chose et je suis sero negatif au derniere nouvelle comme je leurs ai dit ça les à fait rire plus chopé la crampe du poignet que autre chose , le peu que je fais en duo ça vole pas haut , on s'est foutu de ma gueule sur doctissimo à cause de ça, alors ma place je sais pas trop ou elle est , je visite içi pour l'instant ça à l'air d'allé et chez D&J ou je suis pas trop jugé, j'ai participé à deux ateliers de aides et pas trop été regardé de travers par que je mini sexe ni pour mon vocabulaire parfois enfantin .
désolé si j'ai fais un sujet redondant.
par exemple dans l'essonne c'est une séance de massage , parlant en même tant de sujets divers et varié, sympa , juste que du massage, avec une personne qui vient pour nous guidé , je mes l'info car ce coté là est peu connu et peu merité le detour .
Edit: sorry pas bien cherché je voulais surtout mettre en lumiere un coté peu connu de aides sur des activités local apres pour ma place , je suis hypo sexuel , je chose et je suis sero negatif au derniere nouvelle comme je leurs ai dit ça les à fait rire plus chopé la crampe du poignet que autre chose , le peu que je fais en duo ça vole pas haut , on s'est foutu de ma gueule sur doctissimo à cause de ça, alors ma place je sais pas trop ou elle est , je visite içi pour l'instant ça à l'air d'allé et chez D&J ou je suis pas trop jugé, j'ai participé à deux ateliers de aides et pas trop été regardé de travers par que je mini sexe ni pour mon vocabulaire parfois enfantin .
désolé si j'ai fais un sujet redondant.
-
Tempérance
- Messages : 2112
- Inscription : lun. août 13, 2007 12:42 pm
Re: AIDES
L'émission "N'oubliez pas les paroles" avec Nagui hier au soir sur le thème de la St Valentin a permis de récolter 100 000,00 € pour l'association AIDES 
Le duo Arnaud Gidoin et Elodie Frégé ont été très efficace avec un moment particulièrement émouvant en toute fin de parcours avec l'interprétation d'Elodie sur la chanson "L'Aigle Noir" de Barbara et l'émotion poignante d'Arnaud face à l'enjeu
et l'émotion poignante d'Arnaud face à l'enjeu 

Une très belle fin de soirée et un formidable gain pour AIDES.
Moi je dis, YOUPI !
Le duo Arnaud Gidoin et Elodie Frégé ont été très efficace avec un moment particulièrement émouvant en toute fin de parcours avec l'interprétation d'Elodie sur la chanson "L'Aigle Noir" de Barbara

Une très belle fin de soirée et un formidable gain pour AIDES.
Moi je dis, YOUPI !