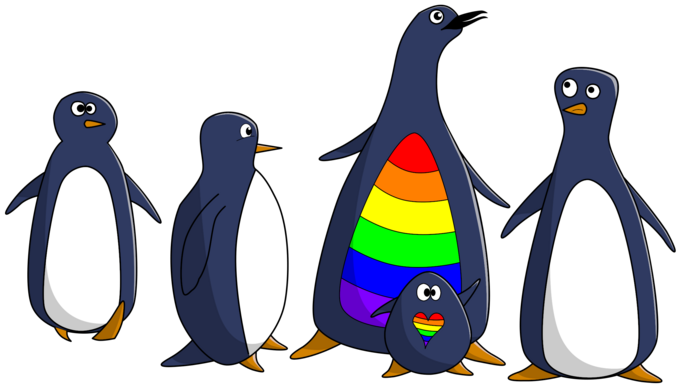(extrait d'une critique de Laurent Rigoulet et Louis Guichard
« Au sortir de l’adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié... » Les premiers mots du synopsis de Marie-Antoinette renvoient directement au cœur des films précédents de la fille Coppola : la pression du monde extérieur sur les rêveries fragiles d’une adolescente, les vertiges du désir et ceux de la désillusion, ces années furtives, parfois tragiques, où les fantasmes flottent et percent « comme des bulles de savon », où l’on sent confusément que les promesses de l’existence pourraient ne pas être tenues… « J’ai l’impression que Marie-Antoinette est confrontée aux mêmes problèmes qu’une lycéenne, dit la réalisatrice. Dans mon film et ses intrigues de palais, il y a des échos de mon premier court métrage sur les histoires entre filles au lycée, la compétition, les ragots… Et, bien sûr, un lien avec Virgin Suicides et Lost in translation. C’est comme une trilogie qui s’achève à présent. Il faut que j’en finisse avec les histoires de filles solitaires, mélancoliques, qui retardent le passage à l’âge adulte... »
Sofia Coppola s’est intéressée au cas de Marie-Antoinette directement après Virgin Suicides.
C’est Dean Tavoularis, le décorateur des films de mon père, qui m’a parlé de Marie-Antoinette lors d’un dîner, raconte-t-elle. Il était en train de lire la biographie de Stefan Zweig et il m’en a décrit quelques passages avec des détails très évocateurs, le quotidien à Versailles, la pression de l’étiquette, les angoisses de Louis XVI et de Marie-Antoinette, leur difficulté à consommer leur union, la solitude de la reine, son tempérament et sa frivolité... Et surtout son âge ! Avant qu’il ne m’en parle, je ne me rendais pas compte à quel point ces gens, qui étaient soudain installés à la tête d’un pays, n’étaient en fait que des adolescents, avec des problèmes d’adolescents… »
Pendant longtemps, la cinéaste s’est perdue dans les méandres de l’Histoire. Après avoir abandonné en route la lecture de la biographie de Stefan Zweig (« trop sévère, trop tranchée »), elle s’est appuyée sur le travail d’Antonia Fraser, l’épouse de Harold Pinter, dont le Marie-Antoinette (1) compile de manière efficace des siècles de recherche sur le destin contrarié de « l’Autrichienne ». « Pendant un moment, j’ai voulu tout traiter, dit la réalisatrice, raconter chaque épisode de son existence, des problèmes d’alcôve à l’affaire du Collier... J’ai fini par trouver mon chemin en resserrant sur ma vision du personnage, sur son côté humain, ses angoisses intimes, sa légèreté, son innocence... »
On lui glisse qu’en France une discussion commence à poindre sur l’entreprise de « béatification » d’une reine que beaucoup jugeaient insensible aux malheurs du peuple, Sofia Coppola fait son agacée, répond sèchement, sans se démonter : « Elle vivait dans un environnement surprotégé, elle ne se rendait pas compte de l’importance de ce qui se passait au-dehors. Je ne suis pas partie en quête d’une vérité historique. On a beaucoup écrit sur elle à partir de témoignages extérieurs, moi, j’ai entièrement construit mon récit sur son point de vue... » Pour Sofia Coppola, Marie-Antoinette est d’abord une jeune femme « qui est passée à côté de sa vie ». « Sofia fait passer, par les descriptions plus que par les dialogues, les petits détails qui cernent bien les angoisses et les colères d’une femme de cet âge, nous confiait l’actrice Kirsten Dunst l’an passé (dans Télérama n° 2893, lire aussi ci-dessous). J’ai l’impression qu’elle parle autant d’elle et de moi que de Marie-Antoinette. »
Sofia Coppola ne fait pas semblant d’être française ni d’avoir vécu au XVIIIe siècle. Non seulement on parle anglais à Versailles, et comme des Californiens (ce ne sera pas la première ni la dernière fois), mais on y déambule, drague, danse et déprime sur des morceaux de punk-rock et de pop (de Bow Wow Wow à Phoenix en passant par The Cure et New Order). Tout est passé au filtre des références de la réalisatrice, de ses goûts et de ses couleurs – orgie de pâtisseries pastel et de tissus assortis. Sans oublier la paire de Converse abandonnée au milieu des chaussures d’époque.
Les films en costumes se partagent souvent entre l’impasse de la reconstitution mortifère et l’écueil des efforts trop voyants pour l’éviter. Marie-Antoinette, théoriquement exposé au second risque, inquiète un peu, au début. L’installation de la princesse à Versailles (à l’âge de 14 ans) paraît s’étirer plus que de raison, entre la monumentalité muséifiée du lieu et le volontarisme du dépoussiérage.
(ndlr : et c'est vrai que sur mon siège de ciné, j'ai souhaité une accélération, un décollage
Et puis « ça » arrive sans crier gare. Quoi ? Que l’agencement des plans, des scènes, l’insistance des anecdotes (Louis XVI incapable d’honorer son épouse) et l’écume des musiques produisent ensemble bien davantage que leur simple somme. Que tout un flux d’émotions imprévues advienne, au-delà de l’appareillage d’un sujet trop connu et de son traitement iconoclaste.
À défaut de maccarons et autres gourmandises et coupes de champ', je me suis régalée du choix des musiques tel ce passage où le dauphin, la dauphine et leur amis font -comme qui dirait- le mur pour pousser sur Paris (en carrosse
J'ai trouvé cette vie "royale" étouffante (ce tel manque d'intimité et de tranquillité)... Ah
Enfin voilà quoi... J'avais un papy et une mamie assis à quelques sièges de moi et le papy n'a pas arrêté de chuchoter pendant tout le film.
C'était gonflant mais à la moitié du film, je me suis dit que la petite grand-mère était peut-être mal voyante ou mal entendante...
Pourtant à la sortie du film, ils m'ont demandé si j'avais aimé car lui, n'a pas du tout aimé...
Je pense que donc, il a refait l'histoire de France pendant la séance
Je lui ai donc expliqué l'intention de Sophia C. et que pour ma part, je savais ce que j'allais voir et que je n'avais pas été déçue même si ce film ne vaut quand même pas tout le tintamarre qu'il ya eu autour et notamment lors de son passage au festival de Cannes (mais il n'a raflé aucun prix)...
Mais bon, moi je le recommanderai parce qu'il offre un autre regard sur cette vie-là et ça renvoie aussi à cette jeunesse dorée qui m'a bien horripilée dans le reportage sur TF1dans "7 à 8" dimanche dernier...
Déjà que jeunesse et surtout adolescence rime avec nombrilisme et égoïsme mais leur rapport avec l'argent... Pff
Pour le coup, je me suis sentie bien plus proche de Benoite Grout qui dans son livre "la touche étoile" nous parle de la condition des "vieux" et "veilles" personnes...
Mais je m'égare dans un galerie qui glace là