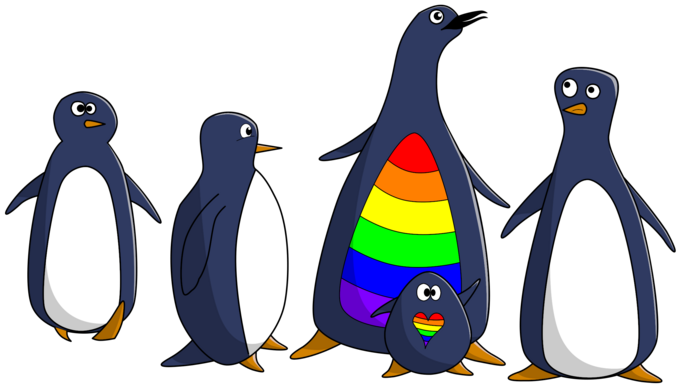|
L'athéisme idiot ?
Kliban a écrit :
Je pense qu'on n'a pas commencé à penser les conséquences éthiques de ces actes et de ces monuments de la pensée humaine.
J'aurais plutôt dit l'inverse en fait... le développement irrationnel des religions poussé par la mondialisation.
Plus le monde est ouvert et plus les gens ont besoin de repère identitaire, que ce soit culturel, social, religieux et etc
(super long. Les questions deviennent difficiles. Je réponds d'abord à Kiwi, rapidement puis très longuement à Etapiscium)
 . Ton analyse me semble tout à fait correcte, mais elle ne parlent que de conséquences non thématisées et non proposées à la réflexion sur le mode du : voilà pourquoi et voilà ce qu'on va pouvoir en faire.
. Ton analyse me semble tout à fait correcte, mais elle ne parlent que de conséquences non thématisées et non proposées à la réflexion sur le mode du : voilà pourquoi et voilà ce qu'on va pouvoir en faire.
Très largement, on se contente 1. de constater a posteriori que le religieux remonte - conséquence de type réactionnaire : on revient à de l'ancien contre les pensées "nouvelles" - et 2. le cas échéant : de suivre ou de combattre le mouvement.
On n'est que dans la réaction, pas dans cette attitude à la fois engagée et distancée, avec toutes les composantes d'analyse et de vision que cela suppose, qui est le signe d'une véritable pensée.
Exceptions confidentielles : Nietzsche et Heidegger, peut-être, mais ils nont pas laissé de courant authentiquement contemporains, sauf peut-être via Deleuze et Derrida - et il y a aussi le cas Badiou - je passe.
@Etapiscium : Quelques points :
1. Je n'ai pas parlé d'inconscient cognitif, mais bien de non-conscient. La différence que tu marques à juste titre entre les deux est bien le signe de la lenteur de la convergence. Mais dans le non-conscient cognitif est en train de se faire jours des éléments non pas de traitements de l'information "trop rapides pour", mais de mémoire - et l'inconscient freudien est un inconscient mnésique essentiellement. C'est de ce côté là qu'il convient de chercher la convergence.
2. Je n'ai réellement pas beaucoup d'intérêt à défendre des thérapies au prétexte qu'elles soignent ou non. Je ne suis pas un soignant. Je ne suis pas engagé dans la psychanalyse comme dans une vérité objective. Et tous ces débats non seulement m'indiffèrent, mais sont pour moi arguties de philosophes, théologiens et moralistes qui finissent par ne plus considérer cela seul qui m'intéresse - le bien- ou mieux-être du patient comme une des variables du problème - alors que c'est le problème lui-même.
Je me fous donc que la psychanalyse ne soit pas une science. Ce n'en est pas une, et nombreux sont les psychanalystes qui le savent - les autres sont majoritairement des idéologues, école (homophobe) de Bergeret en tête.
Je vais plus loin : éthiquement parlant, peu me chaut que telle thérapie ait statistiquement plus de résultats qu'une autre. Cette considération n'est pas éthique, mais économique. Ici la bonne statistique serait : y a-t-il des cas que telle thérapie n'a pas su soigner et qui ont été soignés par une autre ? Cela seul suffit déjà à mes yeux pour que cette autre thérapie soit recommandable - avec les précautions issues de la première statistique.
M'interpelle en revanche le fait que les psys qui m'ont sorti du trou aient eu une solide formation de psychanalyste. Tout comme me hérissent les techniques des TCC - je n'ai aucune envie de devenir un expert de mon propre fonctionnement cérébral, ce n'est pas du tout comme cela que je conçois la santé. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître, au titre de l'éthique évoquée ci-dessus, tout le bienfait des TCC - à mon sens plus des thérapies accessibles à plein de gens, là où la psychanalyse est sans doute appelé à devenir d'un usage plus confidentiel : elles ne font pas la même chose, la psychanalyse n'étant pas une discipline de traitement du symptôme.
3.
Pour ce qui me concerne, je conçois qu'il puisse être pour Mr X plus aliénant - parce que source d'anxiétés par exemple, ou d'arguments politiques douteux - de se représenter l'homme comme une simple bestiole issue de l'évolution - cela rend terriblement difficile une pensée de la morale et de l'action. Alors que l'idée d'un dieu qui lui demandant de faire le bien puisse l'orienter vers une libération de l'angoisse qui lui laisse une liberté d'exploration bien plus importante de sa relation au monde (objets, gens, lui-même, etc.).
Dit en résumé : l'aliénation ne vient pas de la multivocité d'un discours, de sa vérité objectivement construite, ou de sa fausseté objectivement constatée, mais de ce que ce discours me fait perdre en degrés de liberté. L'aliénation ne relève pas de la théorie de l'aconnaissance, mais de l'éthique de l'action. Pour pousser le bouchon : la vérité objectivement construite peut être aliénante - c'est un des sens du nietzschéen "Dieu est mort".
4.
5. La possibilité de remplir le gap, ce n'est qu'à essayer de le remplir qu'on peut la mettre à l'épreuve - et rencontrer éventuellement la preuve de l'impossibilité. D'autant plus qu'il s'agit ici de faire émerger un mode de pensée et un mode d'être nouveaux, et que cela ne peut se faire qu'en plongeant et se laissant transformer par les problèmes. Ce n'est pas une équation que l'on résout avec des moyens éprouvés.
La nécessité de remplir le gap, soit le besoin impérieux de se lancer dans cette aventure là, ne peut se faire sentir que lorsqu'on se retrouve soi-même face à une impossibilité de perdurer dans l'état présent. Qui ne ressent pas cette impossibilité ne peut ressentir la nécessité d'un changement. Elle se présente à moi sous la forme de l'aporie suivante :
- le discours (issu) de la science est objectivant et ne répond pas à nos besoins d'étais éthiques et moraux subjectifs nous permettant d'orienter notre action.
- les discours éthiques et moraux sont repris par des courants philosophiques et/ou religieux dans la quasi certitude que celui qui l'emporterait ne serait pas le plus moral, mais le plus politiquement rusé
- cette guerre de déstabilisation des repères moraux traditionnels est ancienne - elle remonte aux hérésies chrétiennes, et à la structure sociologique du christianisme qui engendre des hérésies de façon nécessaires du fait notamment de la mise au centre de l'individu et non du groupe dans le rapport créateur/créature.
- Nous, Occident, sommes une civilisation du déséquilibre - nous générons du déséquilibre pour mieux aller de l'avant en le résorbant.
Tout cela me pousse à penser que :
a. Nous n'avons pas encore dépassé le déséquilibre de notre grande mutation scientifique -> il y a une légitimité culturelle à tenter cette résorption
b. Le déséquilibre, tel que je le diagnostique ici rapidement, tient dans un espace entre
- les discours et idéologies engendrés par ce que requiert l'attitude scientifique (objectivité, matérialisme, athéisme, etc. qui en science sont de méthode et dans les idéologies extraites deviennent de principe),
- et ce dont ont besoin les individus et les groupes pour vivre de façon qui leur conviennent.
c. Des solutions existent, mais de façon locale, qui subordonnent un côté du déséquilibre à l'autre (le Vatican et son beau concept d'écologie humaine, au contenu tout à ait répugnant ; le matérialisme militant et sa croyance en l'esprit d'un progrès conjoint des valeurs et de la connaissance).
Aucune synthèse entre les deux ne tient, Il faut être doté d'œillères pour le croire, et avoir répondu à a question dans le mépris des inquiétudes de son voisin. Ces deux tendances sont contradictoires et militent chacune pour la suprématie de leur côté du déséquilibre - c'est bien pour cela qu'il y a un déséquilibre, d'ailleurs !
d. Je n'ai pas de réponse à la nature de ces déséquilibres, et surtout pas les réponses idéologiques le plus souvent qui visent à accuser son adversaire de crédulité ou d'erreur - je demanderais à être convaincu que mes adversaires sont effectivement crédules ou qu'ils se trompent.
e. Je suis capable, pour ce qui me concerne, d'effectuer une synthèse entre ces deux tendance opposées, mais elle est interne, floue, difficile à mettre en mots. Je sais qu'il y a un frayage possible à une façon d'être qui soit à la fois respectueuse des besoins de l'action et de la vie humaine et de la connaissance qu'il prend du monde.
Depuis cette connaissance, toute guéguerre entre les deux parties m'apparais comme une bataille puérile - au sens où personne ne cherche réellement une solution, mais plutôt à savoir ui aura le droit d'empocher toutes les billes. Le manque de recul et de volonté dépassionnée d'information dans ces débats, l'assurance aussi de posséder la solution toute cuite, me navrent profondément, surtout venant de soit-disant "rationalistes" - que j'appelle, moi, des théologiens de la raison.
Si le développement est irrationnel, c'est qu'il n'a pas été penséKiwi a écrit :J'aurais plutôt dit l'inverse en fait... le développement irrationnel des religions poussé par la mondialisation.Kliban a écrit : Je pense qu'on n'a pas commencé à penser les conséquences éthiques de ces actes et de ces monuments de la pensée humaine.
Plus le monde est ouvert et plus les gens ont besoin de repère identitaire, que ce soit culturel, social, religieux et etc
Très largement, on se contente 1. de constater a posteriori que le religieux remonte - conséquence de type réactionnaire : on revient à de l'ancien contre les pensées "nouvelles" - et 2. le cas échéant : de suivre ou de combattre le mouvement.
On n'est que dans la réaction, pas dans cette attitude à la fois engagée et distancée, avec toutes les composantes d'analyse et de vision que cela suppose, qui est le signe d'une véritable pensée.
Exceptions confidentielles : Nietzsche et Heidegger, peut-être, mais ils nont pas laissé de courant authentiquement contemporains, sauf peut-être via Deleuze et Derrida - et il y a aussi le cas Badiou - je passe.
@Etapiscium : Quelques points :
1. Je n'ai pas parlé d'inconscient cognitif, mais bien de non-conscient. La différence que tu marques à juste titre entre les deux est bien le signe de la lenteur de la convergence. Mais dans le non-conscient cognitif est en train de se faire jours des éléments non pas de traitements de l'information "trop rapides pour", mais de mémoire - et l'inconscient freudien est un inconscient mnésique essentiellement. C'est de ce côté là qu'il convient de chercher la convergence.
2. Je n'ai réellement pas beaucoup d'intérêt à défendre des thérapies au prétexte qu'elles soignent ou non. Je ne suis pas un soignant. Je ne suis pas engagé dans la psychanalyse comme dans une vérité objective. Et tous ces débats non seulement m'indiffèrent, mais sont pour moi arguties de philosophes, théologiens et moralistes qui finissent par ne plus considérer cela seul qui m'intéresse - le bien- ou mieux-être du patient comme une des variables du problème - alors que c'est le problème lui-même.
Je me fous donc que la psychanalyse ne soit pas une science. Ce n'en est pas une, et nombreux sont les psychanalystes qui le savent - les autres sont majoritairement des idéologues, école (homophobe) de Bergeret en tête.
Je vais plus loin : éthiquement parlant, peu me chaut que telle thérapie ait statistiquement plus de résultats qu'une autre. Cette considération n'est pas éthique, mais économique. Ici la bonne statistique serait : y a-t-il des cas que telle thérapie n'a pas su soigner et qui ont été soignés par une autre ? Cela seul suffit déjà à mes yeux pour que cette autre thérapie soit recommandable - avec les précautions issues de la première statistique.
M'interpelle en revanche le fait que les psys qui m'ont sorti du trou aient eu une solide formation de psychanalyste. Tout comme me hérissent les techniques des TCC - je n'ai aucune envie de devenir un expert de mon propre fonctionnement cérébral, ce n'est pas du tout comme cela que je conçois la santé. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître, au titre de l'éthique évoquée ci-dessus, tout le bienfait des TCC - à mon sens plus des thérapies accessibles à plein de gens, là où la psychanalyse est sans doute appelé à devenir d'un usage plus confidentiel : elles ne font pas la même chose, la psychanalyse n'étant pas une discipline de traitement du symptôme.
3.
Je ne vois pas la difficulté, je dois avouer, et j'aurais besoin que tu précises ton idée de l'aliénation - et de nature : y a-t-il une nature humaine, mais que psy et religion ne peuvent pas dire, ou n'y a-t-il pas du tout de "nature" humaine ? et par ailleurs, est-ce que celui qui peut dire ce qu'est la nature humaine est aussi celui qui sera le moins aliénant ?Plus haut tu parlais le discours objectivant de la science et ses représentations de la science. Pourtant le risque, avec la religion ou avec un domaine comme la psychanalyse (mais aussi avec la nécessité de traiter subjectivement les découvertes de la science) et leur discours tellement ancrés dans le langage et aux multiples interprétations, est d'aliéner l'être humain et de prétendre lui donner une nature qu'il n'a pas.
Pour ce qui me concerne, je conçois qu'il puisse être pour Mr X plus aliénant - parce que source d'anxiétés par exemple, ou d'arguments politiques douteux - de se représenter l'homme comme une simple bestiole issue de l'évolution - cela rend terriblement difficile une pensée de la morale et de l'action. Alors que l'idée d'un dieu qui lui demandant de faire le bien puisse l'orienter vers une libération de l'angoisse qui lui laisse une liberté d'exploration bien plus importante de sa relation au monde (objets, gens, lui-même, etc.).
Dit en résumé : l'aliénation ne vient pas de la multivocité d'un discours, de sa vérité objectivement construite, ou de sa fausseté objectivement constatée, mais de ce que ce discours me fait perdre en degrés de liberté. L'aliénation ne relève pas de la théorie de l'aconnaissance, mais de l'éthique de l'action. Pour pousser le bouchon : la vérité objectivement construite peut être aliénante - c'est un des sens du nietzschéen "Dieu est mort".
4.
Je partage assez cela. Nous nous en nourrissons, oui. Mais nous le faisons encore de façon théologique, c'est-à-dire en plaçant un principe suprême tout en haut de notre réflexion - la Science (qui n'est plus la science qui se fait, donc, mais une entité abstraite, un mieu d'où, un jour, en principe, on devrait pouvoir tout savoir), l'Homme, etc. Nous n'avons jamais réellement mis à l'épreuve un réel athéisme, sinon dans le champ restreint de la politique : la plupart des athées déploient en fait un discours qui a la forme conceptuelle du discours religieux. Seuls les scepticismes peut-être, réussissent quelque chose du tour de force de n'avoir plus à penser en fonction d'un principe - et encore, puisqu'ils pensent contre lui.(Je vais reprendre Freud (Smile) en disant que l'humanité a effectivement été touchée dans son orgueil à travers les découvertes scientifiques majeures (Copernic, Darwin et compagnie). Mais je me demande si l'on ne se nourrit pas déjà subjectivement de ces découverte à travers le scientisme, l'athéisme et autres joyeusetés en isme. La science étant vraiment hors de ces considérations.
Pour prendre du recul, je me demande s'il est seulement possible de relever le défi dont tu parles, et s'il est nécessaire de remplir ce gap.)
5. La possibilité de remplir le gap, ce n'est qu'à essayer de le remplir qu'on peut la mettre à l'épreuve - et rencontrer éventuellement la preuve de l'impossibilité. D'autant plus qu'il s'agit ici de faire émerger un mode de pensée et un mode d'être nouveaux, et que cela ne peut se faire qu'en plongeant et se laissant transformer par les problèmes. Ce n'est pas une équation que l'on résout avec des moyens éprouvés.
La nécessité de remplir le gap, soit le besoin impérieux de se lancer dans cette aventure là, ne peut se faire sentir que lorsqu'on se retrouve soi-même face à une impossibilité de perdurer dans l'état présent. Qui ne ressent pas cette impossibilité ne peut ressentir la nécessité d'un changement. Elle se présente à moi sous la forme de l'aporie suivante :
- le discours (issu) de la science est objectivant et ne répond pas à nos besoins d'étais éthiques et moraux subjectifs nous permettant d'orienter notre action.
- les discours éthiques et moraux sont repris par des courants philosophiques et/ou religieux dans la quasi certitude que celui qui l'emporterait ne serait pas le plus moral, mais le plus politiquement rusé
- cette guerre de déstabilisation des repères moraux traditionnels est ancienne - elle remonte aux hérésies chrétiennes, et à la structure sociologique du christianisme qui engendre des hérésies de façon nécessaires du fait notamment de la mise au centre de l'individu et non du groupe dans le rapport créateur/créature.
- Nous, Occident, sommes une civilisation du déséquilibre - nous générons du déséquilibre pour mieux aller de l'avant en le résorbant.
Tout cela me pousse à penser que :
a. Nous n'avons pas encore dépassé le déséquilibre de notre grande mutation scientifique -> il y a une légitimité culturelle à tenter cette résorption
b. Le déséquilibre, tel que je le diagnostique ici rapidement, tient dans un espace entre
- les discours et idéologies engendrés par ce que requiert l'attitude scientifique (objectivité, matérialisme, athéisme, etc. qui en science sont de méthode et dans les idéologies extraites deviennent de principe),
- et ce dont ont besoin les individus et les groupes pour vivre de façon qui leur conviennent.
c. Des solutions existent, mais de façon locale, qui subordonnent un côté du déséquilibre à l'autre (le Vatican et son beau concept d'écologie humaine, au contenu tout à ait répugnant ; le matérialisme militant et sa croyance en l'esprit d'un progrès conjoint des valeurs et de la connaissance).
Aucune synthèse entre les deux ne tient, Il faut être doté d'œillères pour le croire, et avoir répondu à a question dans le mépris des inquiétudes de son voisin. Ces deux tendances sont contradictoires et militent chacune pour la suprématie de leur côté du déséquilibre - c'est bien pour cela qu'il y a un déséquilibre, d'ailleurs !
d. Je n'ai pas de réponse à la nature de ces déséquilibres, et surtout pas les réponses idéologiques le plus souvent qui visent à accuser son adversaire de crédulité ou d'erreur - je demanderais à être convaincu que mes adversaires sont effectivement crédules ou qu'ils se trompent.
e. Je suis capable, pour ce qui me concerne, d'effectuer une synthèse entre ces deux tendance opposées, mais elle est interne, floue, difficile à mettre en mots. Je sais qu'il y a un frayage possible à une façon d'être qui soit à la fois respectueuse des besoins de l'action et de la vie humaine et de la connaissance qu'il prend du monde.
Depuis cette connaissance, toute guéguerre entre les deux parties m'apparais comme une bataille puérile - au sens où personne ne cherche réellement une solution, mais plutôt à savoir ui aura le droit d'empocher toutes les billes. Le manque de recul et de volonté dépassionnée d'information dans ces débats, l'assurance aussi de posséder la solution toute cuite, me navrent profondément, surtout venant de soit-disant "rationalistes" - que j'appelle, moi, des théologiens de la raison.
Dernière modification par Kliban le dim. août 23, 2009 6:47 pm, modifié 1 fois.
En même temps, la mondialisation ne date vraiment pas d'aujourd'hui : elle a bien plusieurs siècles.J'aurais plutôt dit l'inverse en fait... le développement irrationnel des religions poussé par la mondialisation.
Plus le monde est ouvert et plus les gens ont besoin de repère identitaire, que ce soit culturel, social, religieux et etc
Pour notre époque, je parlerai plutôt comme Emmanuel Todd (Après la démocratie mais aussi Le dialogue des civilisations) de la mort de dieu, et du grand vide métaphysique, mais certainement pas d'un retour du religieux. D'une poussée identitaire aux connotations parfois intégriste ou fondamentaliste (qui est aussi dû au détachement de la religion d'une part de plus en plus importante de la population), comme l'analyse Todd dans le premier bouquin cité), certes, mais pas d'un retour à la foi.
@ Kliban : tu oublies Guattari (L'anti-Oedipe avec Deleuze, car Deleuze en solo, c'est plutôt Présentation de Sacher-Masoch, qui ne fut probablement pas pour rien dans son rapprochement avec Guattari). Et sans Deleuze et Guattari, point de Désir homosexuel de Guy Hocquenghem.
On va laisser venirEtapiscium a écrit :Bon j'ai mis du temps à répondre, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais (même si ça sera une réponse partielle pour l'instant bouh !)
Comme on est total off-topic, j'ai déplacé ma réponse sur la partie "psychanalyse" sur un autre topic. Ce sera mieux là. Je me concentre ici sur quelques détails qui peuvent se ramener au sujet du forum.
Malheureusement pas. Des trucs ici et là, que mon œil a capté, mais je ne me souviens pas où. On trouve des choses intéressante chez Proust, J. "De la volonté", mais ce n'est pas du tout son sujet principal. Comme je l'indiquais, ce ne sont encore que des indications, des curiosités, etc.J'ai pu lire rapidement une publication dessus [= inconscient mnésique], mais je serais intéressé par des références sur ce sujet, si tu en as.
On partage assez, c'est même la position d'un nouvelle vulgate en cours de formation en Occident - matérialisme écaliré, certains l'appellent - mais tu marque une difficulté tout de même dans ton "à partir du moment où il est possible de revenir à sa subjectivité et sa singularité dans le processus". C'est très juste. Mais les conditions de cela ne sont pas aujourd'hui réunies. D'où ma façon de problématiser un fossé entre d'une part la connaissance en troisième personne du monde (les choses, les organismes et cerveaux humaines) et la connaissance en première personne. La neuroèthique - oui, ça existe, c'est tou neuf - s'interroge là-dessus, aujourd'hui, précisément.Je considère qu'il y a une nature humaine(c'est un autre débat, mais même si je ne suis pas... existentialiste, je suis d'accord avec ton idée de liberté aussi...).
Dire qu'un être humain, c'est de la matière organisée et un animal parmi d'autre, à partir du moment où on me le démontre, je ne trouve pas cela aliénant.
La science peut contribuer à la réflexion éthique et métaphysique de l'homme, mais ça ne sera jamais de son domaine. Et je la reconnais volontiers comme un découpage de la réalité (un peu particulier) parmi d'autres.
(et je ne peux pas développer maintenant, mais objectiver l'homme n'implique pas de le dénaturer à partir du moment où il est possible de revenir à sa subjectivité et sa singularité dans le processus. La biologie considère tout de même que chaque être humain est unique de par son code génétique et ses interactions particulières avec l'environnement)
Là, nous ne pouvons pas d'accord. Je n'ai pas besoin d'être rationnellement convaincu de quelque chose pour reconnaître que cette chose a des effets positifs sur moi. Si croire en les anges m'aide à être meilleur, let me believe in angels.Par contre, dans le cas de la religion, qui veut nous dire qu'il est dans notre nature d'être bon, que certains de nos désirs sont à réprimer, ou dans celui de la psychanalyse qui me dit que j'ai une instance psychique remplie de désirs réprimés ou une certaine sexualité dans mon enfance, sans pour autant me le démontrer de manière convaincante. Forcément je trouve que ces deux domaines tendent à circonscrire l'homme de façon obscure. Le but de motiver les actions de l'homme ou de lui permettre une soi disant meilleure connaissance de soi ne justifient pas leur idée de la nature humaine.
Ma morale est pragmatique - mais pas utilitariste. Et je développe sans trop de difficulté des types d'ontologies incompatibles si on les ramène sur le même plan, une ontologie qui a cours dans le champ de la connaissance objective, et une ontologie pratique, qui a cours dans le domaine de la décision et de l'action, et qui, si on la ramène au champ de la connaissance, est une ontologie du "comme si" : c'est "comme si" es anges/Dieu/les ovnis existaient, et cela m'incite à agir de telle ou telle façon.
Mais attention : ramener cette ontologie pratique dans le champ de la connaissance est une chose que je ne fais que pour expliquer à des gens qui ont du mal à imaginer qu'on puisse dissocier les ontologies. De façon pratique, je ne fais jamais comme si. J'y crois. Le comme si ne se manifeste que lorsque je dois immerger (c'est une immersion pas un plongement, pour les ceusses qui auraient fait de la topologie différentielle) les êtres intervenant dans mes actions sur un plan de connaissance rationnelle. Dans le champ de la pratique, ces être ont une autonomie et une efficace que je ne peux leur dénier. Mais, stricto sensu, ils n'existent pas (champ de la connaissance objective).
Dois-je cependant me priver de l'efficacité qu'ils sont sous prétexte qu'un esprit (chagrin, nécessairement
(je précise quand même : je crois rarement aux anges, pas souvent en dieu et jamais aux ovni
Tu peux préciser ? Je n'ai pas trop bien compris ce qu'est cette "même structure qui se répète depuis et qui persistera toujours".Ce qui nous amène à ton dernier point du débat auquel je n'aurais pas le temps de rebondir dessus. Mais une solution même s'il y en aura, me semblera s'inscrire dans la même structure qui se répète depuis et qui persistera toujours (en tous cas, en attendant de mieux considérer ce problème, pour moi la solution relèvera toujours des idéologies...)
B'nuit !
(c'est fatigant tout ça, oh là là ! J'vais aller manger, moi)
wahahahahahahahahaBlinded a écrit :Voila une vidéo qui remettra tout le monde d'accord.
Pardon, Etapiscium, je n'avais pas vu que tu m'avais répondu.
Je retiens de ton dernier cette idée que la science répond mieux aux besoins de l'homme :
Je ne suis pas complètement d'accord. Elle répond mieux à certians besoins de l'homme. Mais, comme tu le notes à juste titre, dans la mesure où elle est aussi une idéologie et donc soumise à es structures de croyances qui sont celles du religieux, elle porte avec elle la définition de ce qui est un "besoin" et de ce qui n'en est pas un. Elle a par exemple tendance à ne pas considérer que le rapport à une transcendance soit un besoin : avec elle vient la croyance que ce rapport relève d'une erreur, qui peut être corrigé.Etapiscium a écrit :On ne peut nier que, malgré que science et religion devraient être deux domaines distincts, la première lui a fait en quelque sorte concurrence en répondant mieux aux besoins de l'homme, et ce faisant a ôté certaines croyances. (Tout en nourrissant les croyances qu'elle engendre ?)
Or ce n'est pas parce que la transcendance n'a pas de poids dans une image scientifique du monde que l'homme n'a pas besoin de se forger un rapport à une transcendance. Premier point.
Second point : même sur les besoins qu'elle satisfait, tu supposes qu'elle y répond toujours mieux que d'autres.
Deux façon de lire ça :
Version faible : elle y a toujours mieux répondu. Ce point est a minima sujet à discussion. Je ne suis pas du tout certain qu'elle réponde mieux à notre besoin de tranquillité, par exemple, ou à notre besoin de définition des causes : la réponse-par-dieu est souvent plus convaincante que la réponse-par-la-théorie-des-cordes. La sciences est aussi un vecteur d'inquiétudes, et n'a pas toujours les moyens de dissiper les inquiétudes qu'elle génère. Je pense que la religion fait mieux de ce côté à, même si je ne suis bien souvent pas du tout d'accord avc les moyens, et que je goûte peu les conséquences.
Version forte : la science n'a pas toujours bien répondu, mais sa dynamique fait qu'elle finira par bien y répondre. Outre que c'est très contestable, on est là dans le pari sur la futur et ça a des goûts de... sotériologie : la science sauveuse de l'humanité. On retombe en pays d'idéologie. On nous demande de croire - contre bien d'autres possibles aussi probables - que la science sauve.
Voilà où le philosophe ne baisse pas les brasD'où l'impossibilité pour moi, d'aboutir à ce que tu appelles un "réel athéisme", qui ne soit pas similaire à des discours religieux. Cette organisation de pensée ne cesse de se répéter sous différentes formes pour remplir une même fonction morale. Si Dieu est mort, Scientisme le remplace. Il est difficile d'inclure la Science, hors de ces considérations, dans l'engrenage.
Pour ma part je suis athé, et je le vis tres bien meme si c'est "idiiot" 
Sincerement je ne voit pas en quoi ce serait idiot, c'est un avis sur la question. Je n'ai pas du tout eu d'éducation vis a vis d'une quelconque religion et je ne m'y suis jamais vraiment interessé de près. J'ai un esprit cartésien et j'ai besoin qu'on me prouve ce que l'on avance. Même si Blaise Pascal à démontré scientifiquement que le fait de croire était un avantage, je n'ai pas éprouvé le besoin de croire ( ce n'est pas faute de ne pas avoir réfléchi sur la question).
Je connais beaucoup d'athé, et je n'ai jamais entendu jusqu'alors de personne qui dénigre une religion ou qui se croit meilleur ( ou plus fort ) qu'un croyant. C'est juste une question de point de vue, et peut etre aussi de caractère ( lui-même en rapport direct avec le formatage de la société).
J'estime avoir eu la posibilité de penser par moi même, et je n'ai jusqu'alors jamais eu de religion qui m'interesse, et je ne m'en souci pas trop. J'ai déjà trop de question existentielle a me poser ^^
Sincerement je ne voit pas en quoi ce serait idiot, c'est un avis sur la question. Je n'ai pas du tout eu d'éducation vis a vis d'une quelconque religion et je ne m'y suis jamais vraiment interessé de près. J'ai un esprit cartésien et j'ai besoin qu'on me prouve ce que l'on avance. Même si Blaise Pascal à démontré scientifiquement que le fait de croire était un avantage, je n'ai pas éprouvé le besoin de croire ( ce n'est pas faute de ne pas avoir réfléchi sur la question).
Je connais beaucoup d'athé, et je n'ai jamais entendu jusqu'alors de personne qui dénigre une religion ou qui se croit meilleur ( ou plus fort ) qu'un croyant. C'est juste une question de point de vue, et peut etre aussi de caractère ( lui-même en rapport direct avec le formatage de la société).
J'estime avoir eu la posibilité de penser par moi même, et je n'ai jusqu'alors jamais eu de religion qui m'interesse, et je ne m'en souci pas trop. J'ai déjà trop de question existentielle a me poser ^^