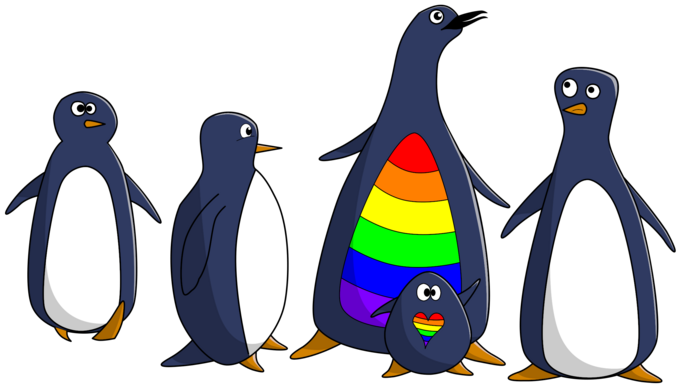Kefka a écrit :Définir un droit comme quelque chose d'opposable à la volonté d'autrui ne renseigne pas sur la source (la nature, autrement dit) même de ce droit, qui est le véritable problème dans les mots de Zü. [...] Les exemples que tu cites font parti de cet ensemble. Ils sont donc des droits opposables à la volonté des autres, mais pas dans un sens commun : ils sont opposables parce qu'ils font partie de la nature même de l'homme et sont l'expression de sa dignité. Au final, la véritable question, à mon sens, est plutôt la suivante : avoir des enfants est-il un droit inhérent à la dignité humaine ou relève-t-il simplement du droit positif (qui n'est pas forcément juste) ?
Donner une source
naturelle à des droits me semble bien hasardeux. Cela revient en effet à s'interroger sur la
nature humaine, concept bien trop vague à mon sens pour en tirer quoi que ce soit d'utile, tout simplement parce que généralement, se poser la question de la nature humaine, c'est en fait se poser la question de la nature de Dieu. Dans la
Condition de l'Homme moderne, Hannah Arendt explique d'ailleurs :
Le problème de la nature humaine [...] paraît insoluble aussi bien au sens psychologique individuel qu’au sens philosophique général. Il est fort peu probable que, pouvant connaître, déterminer, définir la nature de tous les objets qui nous entourent et qui ne sont pas nous, nous soyons jamais capable d’en faire autant pour nous-mêmes : ce serait sauter par dessus notre ombre. De plus, rien ne nous autorise à supposer que l’homme ait une nature ou une essence comme en ont les autres objets. En d’autres termes, si nous avons une nature, une essence, seul un dieu pourrait la connaître et la définir. [...] C’est pourquoi les tentatives faites pour définir la nature humaine s’achèvent presque invariablement par l’invention d’une divinité quelconque, c’est-à-dire par le dieu des philosophes qui, depuis Platon, s’est révélé à l’examen comme une sorte d’idée platonicienne de l’homme. Certes, en démasquant ces concepts philosophiques du divin, en y montrant les conceptualisations de qualités et de facultés humaines, on ne prouve pas, on ne fait même rien pour prouver la non-existence de Dieu ; mais le fait que les essais de définition de la nature de l’homme mènent si aisément à une idée qui nous frappe comme nettement surhumaine et s’identifie par conséquent avec le divin, peut suffire à rendre suspect le concept même de « nature humaine ».
Et en effet, dire qu'un droit fait partie de la nature humaine, c'est revendiquer quelque chose sur des principes que l'autre peut très bien ne pas accepter. Ce qui signifie la fin de toute discussion : inclure un droit dans la nature humaine, ou ne pas l'inclure, est quelque chose contre lequel on ne peut pas véritablement argumenter, exactement de la même manière que l'on ne peut discuter lorsque l'autre argue de ses préceptes religieux pour défendre son point de vue.
Néanmoins, il reste possible de qualifier un droit comme étant « naturel » dès lors que tout le monde s'accorde à dire que c'en est un, car alors aucun débat n'est plus nécessaire. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre la citation que tu fais de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui donne une liste de droits « naturels, inaliénables et sacrés ». Cela signifie : voici les droits sur lesquels aucun débat ne doit avoir lieu.
On rencontre d'ailleurs un peu le même problème avec le concept fourre-tout de « dignité humaine ». Certains juristes constatent d'ailleurs que l'on qualifie maintenant comme des « atteintes à la dignité humaine » exactement ce qu'on appellait autrefois des « atteintes aux bonnes mœurs »... On a changé l'expression pour une autre, mais cela reste le même concept vague qui permet de défendre un peu tout et n'importe quoi sans avoir à se justifier. J'ajoute, concernant la Déclaration universelle des droits de l'homme que tu cites et qui emploie le mot « dignité », que cette « déclaration » n'est qu'un ensemble de paroles creuses qui ne sert qu'à donner une image de défenseurs des droits de l'hommes à certains politiciens, car
elle n'a aucune valeur légale !
Kefka a écrit :À raisonner comme tu le fais, tu vois "le droit à l'enfant" comme un droit autonome, dont tu dénies le caractère "obligatoire" défendu par les tenants de l'homoparentalité. Or, il est possible d'en faire le prolongement d'un autre droit, le droit à l'égalité devant la loi.
Il est en effet possible de défendre le droit l'élever, d'avoir ou d'adopter des enfants pour les couples homosexuels en utilisant le droit à l'égalité devant la loi : il est totalement absurde que l'on autorise par exemple des célibataires à adopter, mais que cela soit refuser à un individu pour la seule raison qu'il est en couple avec une personne de même sexe ! Mais utiliser un raccourci en employant le terme de « droit à l'enfant », c'est un manque de précision et une source de confusion.
Fade Out a écrit :Si on raisonne par interdiction le débat est plus clair, car l'essentiel des discriminations réside encore dans les interdictions :
- doit on interdire à un homo d'adopter ?
- doit on interdire à une femme en couple homo de se faire inséminer ?
- et si oui, pour quelle raison ?
Il y a une différence fondamentale entre les deux. Dans le cas d'une insémination, il s'agit d'interdire (ou pas). Dans le cas de l'adoption, il s'agit de ne pas autoriser (ou d'autoriser). À la différence de l'insémination, l'adoption nécessite que la Société accepte de traiter les parents adoptifs comme elle traiterait les parents biologiques : on ne peut donc pas « interdire ».