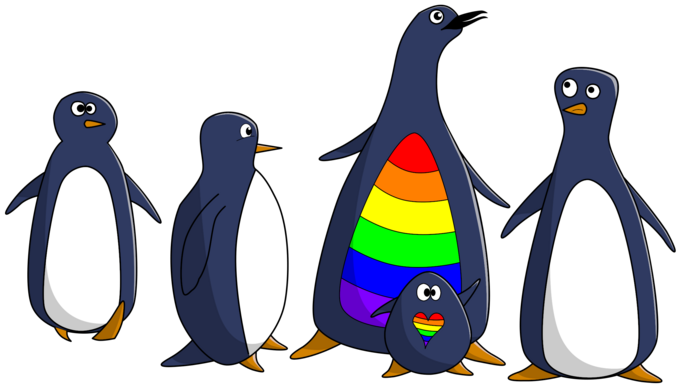Pragma a écrit :vivien a écrit :J'avoue que je mens à chaque don, pas vraiment le choix. Je ne sais pas ce qui se passerait d'ailleurs si je répondais "oui" à la question "avez-vous eu des rapports homosexuels" ? Refus de la prise de sang ?
Bonjour vivien.
Oui tu aurais été exclu, ils ont des instructions qui viennent du ministère. J'avais une fois discuté avec le médecin chargée du questionnaire préalable au don, je savais que j'étais homosexuel, mais je n'avais pas encore eu de rapports à cette époque. Je l'avais dit au médecin, et j'avais demandé comment est-ce que ça s'appliquait aux femmes, et elle m'avait répondu simplement qu’elle « ne posait pas cette questions aux femmes ».
On peut trouver
ici l'arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang.
En lisant de près les contre-indications, on s'aperçoit que :
-ne sont exclus du don que les hommes ayant couché avec d'autres hommes
-les femmes ne sont pas concernés
-les homosexuels masculins vierges non plus
-les hétéros masculins ayant couché avec un homme sont aussi exclus du don
Conclusion : je doute d'une homophobie institutionnalisée dans le don du sang
Ensuite. Concernant le pourquoi du comment de cette exclusion.
Sources
Les décisions politiques faites s'appuient majoritairement sur les rapports de l'Institut de Veille Sanitaire (l'InVS) dont voici les fonctions :
1) la surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population
2) la veille et la vigilance sanitaires
3) l'alerte sanitaire
4) une contribution à la gestion des crises sanitaires
C'est donc au nom de la première mission citée que cet organisme produit des rapports fréquents sur les données épidémiologiques du VIH et du SIDA en France. On peut trouver
ici des liens renvoyant vers les rapports de 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que sur les données issues de la déclaration obligatoire d'une infection au VIH jusqu'au 31 juin 2010.
L'InVS a aussi mené en 2009 une enquête, intitulée Prévagay, auprès des homos fréquentant les "lieux de convivialité gay". La synthèse des conclusions est disponible
ici.
Soucis méthodologiques liés à la population homosexuelle
1) Il est difficile de définir ce qu'est un homosexuel. De nombreuses interrogations se posent concernant la réponse de cette question :
-faut-il ne retenir qu'un comportement sexuel biologique ?
-doit-on y inclure un comportement et une identité sociale ?
-comment passer outre les préjugés culturels (par exemple, en Amérique du Sud, c'est celui qui se fait pénétrer qui est considéré comme homosexuel, alors que celui qui pénètre est hétérosexuel : on retrouve là les clichés de la "femme pénétrée" et de "l'homme pénétrant") ?
Premier biais.
2) La population homosexuelle est par définition discrète : on peut difficilement identifier un homosexuel dans la rue. D'où la nécessité pour les organismes comme l'InVS d'aller directement à la "source" : les "lieux de convivialité gay". Or, on sait très bien que ce ne sont pas forcément des lieux visités par des individus respectant à la lettre les principes de précaution sexuels.
Deuxième biais.
Conclusions :
1) Au regard des données produites, l'exclusion est justifiable (
ce qui ne veut pas dire qu'elle est justifiée, ne déformez pas ce que j'écris).
2) Une autre donnée doit être prise en compte : l'acceptabilité sociale face aux risques. Cette dernière est très ténue et va en diminuant depuis longtemps. Les politiques doivent avant tout se fonder sur la manière dont les électeurs perçoivent le risque de transmission virale lors d'une transfusion sanguine. Tout risque de contamination étant vu comme inacceptable, on ne peut pas fonder un retour sur les conditions de don du sang sans provoquer en même temps un retour du risques dans ce domaine. En effet, plus les chaînes de causalité sont maîtrisées, plus l'on attend de l'Etat (et des individus) qu'il protège des situations à risques.
3) L'axiome politique qui prime actuellement est le principe de précaution. Il est défini ainsi : "
Ce nouveau concept se définit par l’obligation pesant sur le décideur privé ou public de s’astreindre à une action ou de s’y refuser en fonction du risque possible. Dans ce sens, il ne lui suffit pas de conformer sa conduite à la prise en compte des risques connus. Il doit en outre apporter la preuve, compte tenu de l’état actuel de la science, de l’absence de risque." (Vertus et limites du principe de précaution : réflexions du Conseil d'État sur le droit de la santé, in Conseil d'État rapport public 1998, Études et Documents n°49, 1998, p. 256-260.). La volonté de certains homos de revenir sur les interdictions qui sont faites contre-dit directement cette notion
4) "Et puis, je trouve absurde cette différence faite entre hétéros et homos sur le principe que les "gays" auraient une vie dissolue, seraient des infidèles chroniques à partenaires multiples" : ceci est un jugement de valeur
ad hominem qui ne s'appuie sur rien.