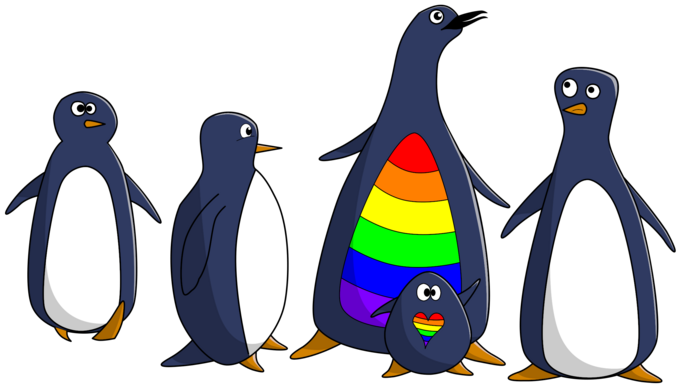Si je vous écrivais ici un petit texte avec des extraits de notes de cours de philo sur la caresse et le toucher, vous seriez pour ? Ou bien ça craint du délire d'intello qui pue dans un club consacré aux sens ? En tout cas ça me ferait une excellente raison de procrastiner
[Club] : La caresse c'est la liesse
Re: La caresse c'est la liesse
J'adore ce topic.
Si je vous écrivais ici un petit texte avec des extraits de notes de cours de philo sur la caresse et le toucher, vous seriez pour ? Ou bien ça craint du délire d'intello qui pue dans un club consacré aux sens ? En tout cas ça me ferait une excellente raison de procrastiner
Si je vous écrivais ici un petit texte avec des extraits de notes de cours de philo sur la caresse et le toucher, vous seriez pour ? Ou bien ça craint du délire d'intello qui pue dans un club consacré aux sens ? En tout cas ça me ferait une excellente raison de procrastiner
-
Œil-de-nuit
- Messages : 710
- Inscription : dim. oct. 16, 2011 8:34 pm
Re: La caresse c'est la liesse
Je trouve que c'est une excellente idée!!!Juuune a écrit :J'adore ce topic.
Si je vous écrivais ici un petit texte avec des extraits de notes de cours de philo sur la caresse et le toucher, vous seriez pour ? Ou bien ça craint du délire d'intello qui pue dans un club consacré aux sens ? En tout cas ça me ferait une excellente raison de procrastiner
Re: La caresse c'est la liesse
Ouais, procastine, si le coeur t'en dit^^ 
Re: La caresse c'est la liesse
Fan de Martina Hingis ?New starting a écrit :La caresse, c'est une Suissesse ?
Re: La caresse c'est la liesse
Voilà les gars, j'ai procrastiné ! Voilà le travail.
À lire en se caressant en méditant.
La main comme ouverture au monde, l'âme au bout des doigts, la caresse.
L'espace vécu n'est pas un espace-milieu, milieu extérieur dans lequel seraient disposées les choses, selon une vision intellectuelle. C'est nous qui sommes porteurs du sens de l'espace : nous spatialisons le monde - notre corps n'est pas seulement spatialisé mais aussi spatialisant. Nous orientons un espace selon le sentiment de droite et de gauche. La main, elle, est faite non pour se retourner sur elle-même, mais pour rendre le monde à lui-même. Il ne s'agit pas seulement de manipuler le monde mais de le rejoindre, de le faire sien : c'est en comblant l'abîme qui nous sépare du monde que nous comblons l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes. La main n'est pas faite que pour prendre, ce n'est pas un simple organe de préhension. En fait, c'est par la main que nous est donné un monde, et la main possède déjà une dimension éthique. Une main sans monde n'a pas d'avenir. La deixis, c'est le recours au démonstratif, quand on montre avec le doigt. L'enfant utilise d'abord la main pour s'ouvrir un monde, avant que le langage lui-même reprenne cette fonction déictique (quand je dis « cet objet », c'est l'équivalent de l'index qui pointe).
Éloge du toucher.
La main est l'organe du toucher. Le toucher a été le plus souvent dévalorisé parmi les cinq sens, selon une approche idéaliste de la condition humaine : le sens privilégié chez Platon, par exemple, c'est la vue car elle est possible à distance. Mais le toucher apparaît comme privilégié quand on prend comme objet l'homme incarné, et non seulement son intellect. Plus qu'un contact, le toucher est un sens de la présence qui débouche sur l'expérience de la rencontre. Il implique non seulement la conscience de l'altérité, mais aussi le désir de faire cesser la distance qui sépare les consciences (alors que la vue suppose au contraire cette distance). L'homme, quand il touche de sa main, tente d'émigrer hors de lui pour aller à la rencontre de l'autre. Mais surtout, le toucher est le seul de nos sens à être nécessairement chargé d'un élément de réciprocité : on ne peut pas toucher sans être soi-même touché (cela peut être vrai au sens affectif aussi). Ce double toucher produit une réflexion sur nous-mêmes. Alors que nous ne pouvons voir nos yeux que par l'artifice du miroir, en tant qu'il abolit la séparation, le toucher implique une socialité originaire de la main. C'est aussi pour cette raison que le langage semble commencer par les mains. La main est déjà un langage. Lucrèce développe une philosophie du tactile, du tangible. Tout est affaire de toucher : pour lui, les quatre autres sens s'y réduisent. Sentir, entendre, sont des émanations du toucher (ce sont des ondes), des sens du toucher déguisés. Et même le regard peut être compris comme un toucher. Dans le bas-relief, le regard touche l’œuvre, appréciant ses aspérités.
La sublimation par la caresse.
Dans la caresse, la main dépasse en la sublimant sa fonction de préhension. Elle ne s'empare pas, elle ne cherche pas tant à prendre qu'à donner (du plaisir à l'autre), en effleurant. Nous découvrons là de l'insaisissable : il y a des éléments qui ne sont pas seulement « à prendre » dans le corps d'autrui. La main trouve sa vérité quand elle s'ouvre à l'inappropriable (c'est le contraire du viol). Je ne peux naître à moi-même que par la grâce d'un autre qui s'offre à ma caresse. (Kierkegaard va jusqu'à dire que par la caresse, l'homme contracte une dette infinie.) On peut citer l'Être et le néant aussi :
La chair de l'autre et la chair du monde sont célébrées par la caresse, et elles me réveillent de mon sommeil terrestre ou terreux. La main libre, c'est celle qui est révélée au contact de la chair d'autrui. Donner la main, c'est le contraire d'une prise (que ce soit pour deux amoureux, à un enfant, ou bien à un mourant), c'est l'expérience de la douceur de la main. La main libre ne saisit rien mais accueille silencieusement la parole de l'autre chair : la main ne fait pas que saisir, serrer. On passe de la prise au don.
Brève phrase de conclusion puisée chez J.Brun :
À lire en se caressant en méditant.
La main comme ouverture au monde, l'âme au bout des doigts, la caresse.
L'espace vécu n'est pas un espace-milieu, milieu extérieur dans lequel seraient disposées les choses, selon une vision intellectuelle. C'est nous qui sommes porteurs du sens de l'espace : nous spatialisons le monde - notre corps n'est pas seulement spatialisé mais aussi spatialisant. Nous orientons un espace selon le sentiment de droite et de gauche. La main, elle, est faite non pour se retourner sur elle-même, mais pour rendre le monde à lui-même. Il ne s'agit pas seulement de manipuler le monde mais de le rejoindre, de le faire sien : c'est en comblant l'abîme qui nous sépare du monde que nous comblons l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes. La main n'est pas faite que pour prendre, ce n'est pas un simple organe de préhension. En fait, c'est par la main que nous est donné un monde, et la main possède déjà une dimension éthique. Une main sans monde n'a pas d'avenir. La deixis, c'est le recours au démonstratif, quand on montre avec le doigt. L'enfant utilise d'abord la main pour s'ouvrir un monde, avant que le langage lui-même reprenne cette fonction déictique (quand je dis « cet objet », c'est l'équivalent de l'index qui pointe).
Éloge du toucher.
La main est l'organe du toucher. Le toucher a été le plus souvent dévalorisé parmi les cinq sens, selon une approche idéaliste de la condition humaine : le sens privilégié chez Platon, par exemple, c'est la vue car elle est possible à distance. Mais le toucher apparaît comme privilégié quand on prend comme objet l'homme incarné, et non seulement son intellect. Plus qu'un contact, le toucher est un sens de la présence qui débouche sur l'expérience de la rencontre. Il implique non seulement la conscience de l'altérité, mais aussi le désir de faire cesser la distance qui sépare les consciences (alors que la vue suppose au contraire cette distance). L'homme, quand il touche de sa main, tente d'émigrer hors de lui pour aller à la rencontre de l'autre. Mais surtout, le toucher est le seul de nos sens à être nécessairement chargé d'un élément de réciprocité : on ne peut pas toucher sans être soi-même touché (cela peut être vrai au sens affectif aussi). Ce double toucher produit une réflexion sur nous-mêmes. Alors que nous ne pouvons voir nos yeux que par l'artifice du miroir, en tant qu'il abolit la séparation, le toucher implique une socialité originaire de la main. C'est aussi pour cette raison que le langage semble commencer par les mains. La main est déjà un langage. Lucrèce développe une philosophie du tactile, du tangible. Tout est affaire de toucher : pour lui, les quatre autres sens s'y réduisent. Sentir, entendre, sont des émanations du toucher (ce sont des ondes), des sens du toucher déguisés. Et même le regard peut être compris comme un toucher. Dans le bas-relief, le regard touche l’œuvre, appréciant ses aspérités.
La sublimation par la caresse.
Dans la caresse, la main dépasse en la sublimant sa fonction de préhension. Elle ne s'empare pas, elle ne cherche pas tant à prendre qu'à donner (du plaisir à l'autre), en effleurant. Nous découvrons là de l'insaisissable : il y a des éléments qui ne sont pas seulement « à prendre » dans le corps d'autrui. La main trouve sa vérité quand elle s'ouvre à l'inappropriable (c'est le contraire du viol). Je ne peux naître à moi-même que par la grâce d'un autre qui s'offre à ma caresse. (Kierkegaard va jusqu'à dire que par la caresse, l'homme contracte une dette infinie.) On peut citer l'Être et le néant aussi :
Non seulement la caresse fait découvrir à autrui son corps comme chair (donc comme quelque chose dépassant l'outil, l'instrument), donc comme doté d'une sensibilité qui le fait tressaillir, mais je découvre aussi dans cette expérience mon corps comme chair.En caressant autrui, je fais naître sa chair sous ma caresse, sous mes doigts. La caresse est l'ensemble des cérémonies qui incarnent autrui. (…) La caresse est faite pour faire naître par le plaisir le corps d'autrui à autrui et à moi-même comme passivité touchée, dans la mesure où mon corps se fait chair pour le toucher avec sa propre passivité.
La chair de l'autre et la chair du monde sont célébrées par la caresse, et elles me réveillent de mon sommeil terrestre ou terreux. La main libre, c'est celle qui est révélée au contact de la chair d'autrui. Donner la main, c'est le contraire d'une prise (que ce soit pour deux amoureux, à un enfant, ou bien à un mourant), c'est l'expérience de la douceur de la main. La main libre ne saisit rien mais accueille silencieusement la parole de l'autre chair : la main ne fait pas que saisir, serrer. On passe de la prise au don.
Brève phrase de conclusion puisée chez J.Brun :
Si les paroles peuvent être touchantes, c'est parce que les gestes de la main peuvent être éloquents.
Re: La caresse c'est la liesse
Ouais. La caresse c'est bien quoi. 
Re: La caresse c'est la liesse
Eh ben, les caresses font florès...
-
Cyclothymia
- Messages : 693
- Inscription : mer. mars 30, 2011 10:26 pm
Re: La caresse c'est la liesse
Pour la forme calembouresque de ce club je proposerais bien La caresse c'est mon vin de messe mais comme je suis juste la personne la moins tactile du monde je vois pas trop ce que je ferais dans ce club ( de transmetteur de gale... oui j'ai lu le forum dans ses plus bas fonds ).