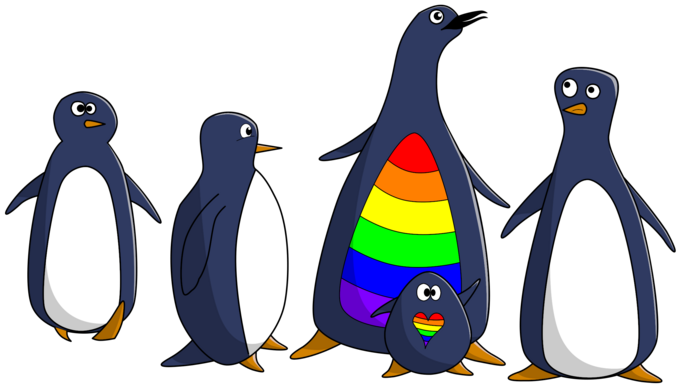Perso les gender studies, je m'y intéresse surtout dans mon domaine, c'est à dire en histoire géographie.
Il faut dire que lorsque je faisais mes études universitaires, c'était un sujet émergent et passionnant, surtout en géographie. Je me concentrerai par contre sur les productions françaises, hein...
En géographie, les travaux des premiers géographes parus dans des revues géographiques (pas de livre réellement en France pour le moment sur sujet encore aujourd'hui à ma connaissance), les premiers géographes s'interrogeaient sur la façon dont l'homosexualité pouvait s'inscrire dans l'espace. Au début c'est vu donc développer une longue liste d'études de quartiers gays dans les métropoles occidentales européennes et américaines, illustrant ainsi la théorie des espaces centraux et le processus de gentrification. Pour Paris, l'auteur de référence est Emmanuel Redoutay, dont l'article fondateur est (à ma connaissance) :
- Emmanuel Redoutey, “Géographie de l’homosexualité à Paris, 1984-2000″, Urbanisme, n°325, 2002, pp. 59-63.
Mais cette approche avait une portée incomplète car non universelle (le monde non occidental n'ayant que rarement des quartiers gays ou alors au stade embryonnaire) et réductrice (les commerces gays ne représentant qu'une infime facette des homosexuels). mais à l'époque, c'était la base de données la plus facile à trouver, à observer et à spatialiser.
Ceci fait, la liste des quartiers gays épuisés, les géographes ont commencé à s'intéresser à la géographie invisible de l'homosexualité, celle qui ne se manifeste pas spatialement par les activités commerciales mais par la concentration d'homosexuel(le)s et les démonstrations affectives homosexuelles dans l'espace public, champ très intéressant car cette spatialisation pouvait dépendre du lieu (proximité ou non d'un quartier gay), mais aussi, et c'est là que cela devient intéressant, de l'heure (contraste entre le calme durant les heures de bureau et la foule après le travail, la nuit de fête dans les quartiers gays ou dans des lieux de drague), du sexe et du genre (contrastes entre la visibilité entre les gays et les lesbiennes)... Ceci illustra alors le changement d'échelle (du local au global, de l'individu à la communauté), acte nécessaire en géographie, mais auparavant absent dans les précédents travaux se concentrant sur les quartiers gays. Ceci fut permis notamment à partir des réflexions de la géographe Marianne Blindon, dont l'article fondateur fut :
- Marianne Blidon, « La casuistique du baiser. L'espace public, un espace hétéronormatif », Echogéo, n°5, 2008. (disponible en PDF sur le net)
Dès lors, sa réflexion sur le sujet a fait de Marianne Blindon une des premières à réfléchir sur l'épistémologie de la géographie des homosexualités, et une référence, grâce à son article :
- Marianne Blidon, « Jalons pour une géographie des homosexualités », L'Espace géographique, n°2, 2008, pp. 175-189. (lui aussi disponible sur le net gratuitement)
Les bases épistémologiques posées, les études géographiques de l'homosexualité ont pu se diversifier.
On a pu alors voir éclore des études sur les espaces de la sexualité homosexuelle, comme le fit Emmanuel Redoutey, comme dans :
- Emmanuel Redoutey, "Drague et crusing", EchoGéo, n° 5, 2008. (disponible sur le net gratuitement)
Il fit d'ailleurs il y a quelques années un article dans Têtu sur la géographie de la drague au bois de Vincennes, très intéressante car souvent invisible et fluctuante dans la journée et le temps, dépendant aussi de la fréquentation du public, des contrôles de police...
Ou encore des travaux sur le tourisme homosexuel et ses conséquences spatiales et ses flux, comme le fit Stéphane Leroy
- Stéphane Leroy et Emmanuel Jaurand, « Le littoral : un paradis gay ? » (avec Emmanuel Jaurand), in Actes du colloque Le Littoral : Subir, Dire, Agir, 2008, Lille, IFRESI-MESHS-CNRS. (lui aussi disponible gratuitement sur le net)
Ou encore sur la géographie des unions homosexuelles.
Mais surtout, les géographes peuvent commencer à sortir leurs oeillères du monde occidental pour explorer les autres régions du monde où l'homophobie ne rend pas la visibilité homosexuelle très facile. Seul problème : ils ne sortent pas assez de France pour pouvoir le faire...
Un exemple, pas totalement géographique mais en partie sociologique :
- Gianfranco Rebucini, "Lieux de l’homoérotisme et de l’homosexualité masculine à Marrakech", L'espace politique, n° 13, 2011. (disponible sur le net gratuitement)
En histoire, cela a commencé par l'étude de l'homosexualité par période et pays ou civilisation.
Mon livre préféré dans ce sens est le livre de Florence Tamagne (en fait, une refonte de sa thèse universitaire) :
- Florence Tamagne, "Histoire de l'homosexualité en Europe - Berlin, Londres, Paris, 1919-1939", 2000, éditions du Seuil (en rupture de stock aujourd'hui, mais trouvable sur les sites de ventes entre particuliers). Une étude comparative de l'homosexualité dans trois pays aux législations différentes dans la première moitié du 20ème siècle. Un pavé richement documenté même si pas toujours facile à lire (puisqu'adapté d'une thèse). D'ailleurs, il est à signaler que florence Tamagne signe un article "Le marié était une femme" dans le premier numéro hors série du magazine Marianne / L'Histoire consacré à l'histoire du couple, où elle raconte l'histoire de femmes qui ont pu célébrer leur union avec d'autres femmes dès le 18ème siècle.
Mais avec le temps, le champs épistémologique s'est diversifié. Ainsi, après avoir étudié l'homosexualité à travers les différentes époques et civilisations, certains ont commencé à s'intéresser plutôt à l'homophobie et à l'hétérosexualité, bref aux regard des autres sur les homosexuels. La démarche est intéressante et permet ainsi de montrer que l'homosexualité est d'abord une notion construite par une société entière et non par un groupe. Les Québécois sont en avance sur ce sujet par rapport aux Français.
Je citerais deux ouvrages :
- Ginette Pelland, "l'homophobie, un comportement hétérosexuel contre nature", 2005, Québec Amérique (ouvrage québécois à la fois sociologique mais avec un survol historique occidental non négligeable)
- Louis Georges Tin, L'Invention de la culture hétérosexuelle, 2008, Éd. Autrement. Où il explique que l'hétérosexualité est née au Moyen-Age grâce à l'Eglise. Ce qui a définit de facto par opposition notamment l'homosexualité.
Voilà voilà... J'ai peut-être été un peu long, là, non ?